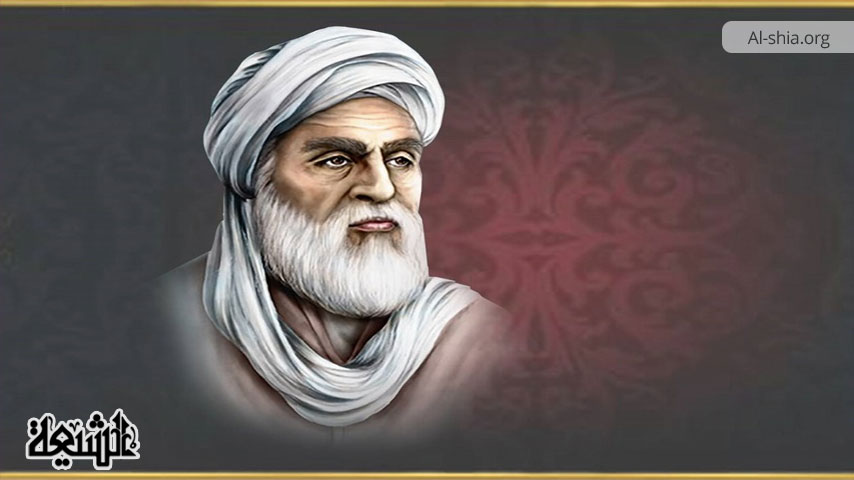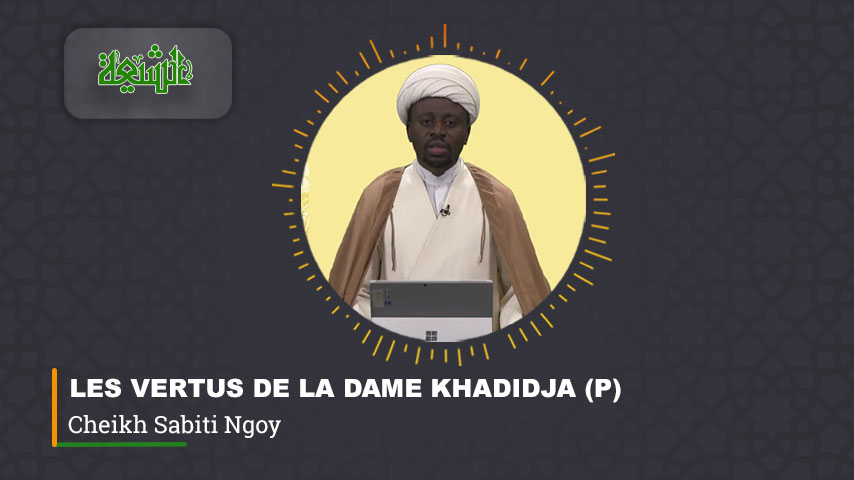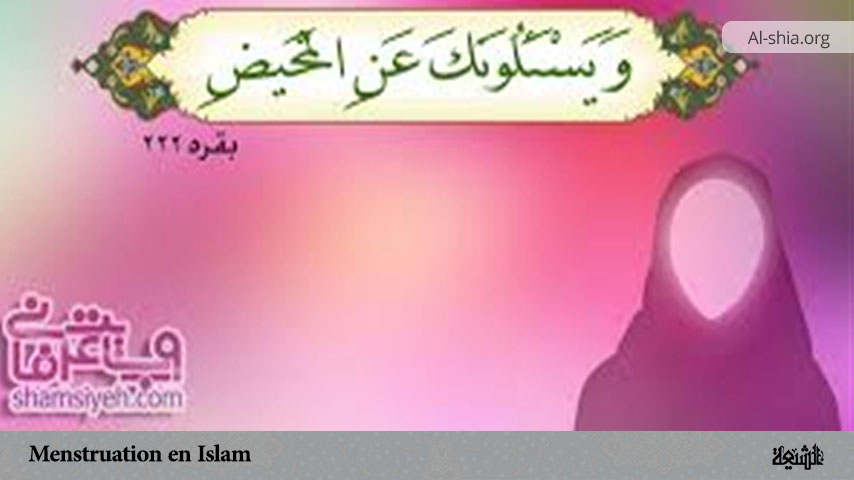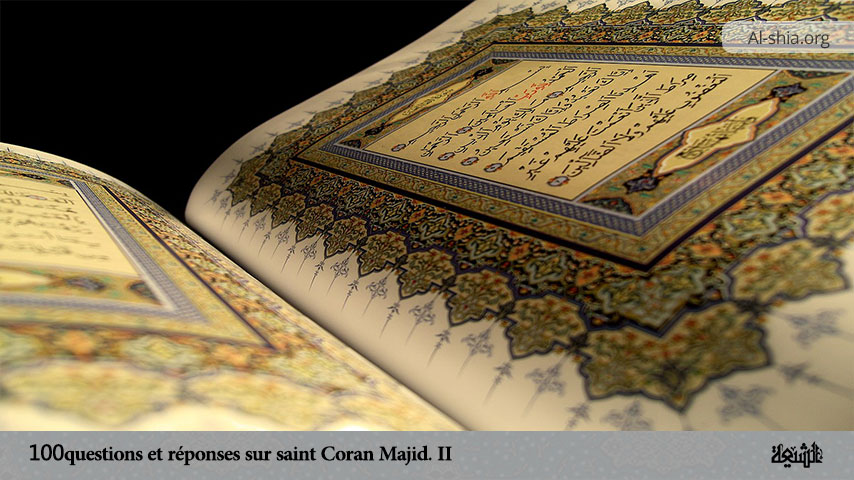Les savants occupent une place centrale, servant de guides spirituels et intellectuels pour la communauté. Cheikh Bahaï fait partie de ces érudits sont reconnus pour leur capacité à interpréter les textes islamiques et à fournir des directives juridiques et morales. Ce regard sur les savants chiites vise à explorer la vie et les contributions de quelques-uns des plus éminents et qui ont eu à façonner la pensée et la pratique chiite au fil des siècles.
Les savants chiites ne se limitent pas à la transmission du savoir ; ils sont également des piliers de la communauté, jouant un rôle crucial dans la préservation et l’évolution de la tradition chiite. Depuis les premiers siècles de l’Islam jusqu’à nos jours, ces figures ont non seulement compilé et interprété les hadiths, mais ont aussi contribué à la philosophie, à la théologie et à la jurisprudence islamiques et à d’autres sciences telles que la mathématique, la chimie, la littérature, médecine etc. En examinant la vie et l’œuvre de ces éminentes personnalités, nous pourrons mieux comprendre l’impact durable qu’ils ont eu sur l’Islam chiite.
Cheikh Bahau din al-Amili
Bahau din Muḥammad ibn Ḥusayn al-Amili (953–1030 H / 1546–1621 ap. J.-C.), connu sous le nom de Cheikh Bahaï, est un éminent savant chiite né le 17 Muḥarram 953 H à Baalbek[1]. Il passa son enfance dans le village de Juba au Jabal amil[2]. Son père, Izz al-Dīn Ḥusayn ibn Abd al-Ṣamad, fut élève de Shahid al-Thānī (mort en 966 H)[3]. Il descend de al-Ḥārith al-Hamdānī, un compagnon de l’Imam Ali, ce qui lui vaut la nisba de al-Ḥārithī al-Hamdānī[4].
Formation et maîtres de Cheikh Bahaï
La majeure partie de la formation intellectuelle de Cheikh Bahaï eut lieu à Qazvin, qui était alors un centre d’études religieuses très actif. Après son séjour à Qazvin, il poursuivit ses études à Ispahan. Son premier et principal maître fut son propre père, Zayn al-Din Ali al- amili, auprès de qui il étudia le tafsir (exégèse coranique), le hadith, la littérature arabe, ainsi que certains éléments des sciences rationnelles (maʿqūlāt). Il reçut également de lui une autorisation de transmission des traditions prophétiques (ijāza).
Parmi les autres maîtres de Cheikh Bahaï, on peut citer :
- Mullā ʿAbd Allāh Yazdī
- Mullā ʿAlī Muzahhab
- Mullā ʿAlī Qāʾinī
- Mullā Muḥammad Bāqir Yazdī
- Cheikh Aḥmad Gachāyī
- Cheikh Abd al-ʿĀlī al-Karakī (993 H), fils du célèbre jurisconsulte al-Muḥaqqiq al-Karakī
- Maḥmūd Dehdār (1016 H)
- Muḥammad ibn Muḥammad ibn Abī al-Laṭīf al-Maqdisī al-Shāfiʿī[5]
Formation intellectuelle et environnement politique
Un an après sa naissance, sa famille retourna au Jabal Amil, mais en raison de l’insécurité qui suivit l’assassinat de Shahid al-Thānī et sous l’invitation du Shah Ṭahmāsb Ier, elle migra vers l’Iran[6]. La migration fut aussi encouragée par Cheikh Ali Minshār al-Karkī, alors Sheikh al-Islam d’Ispahan[7].
Selon un manuscrit autographe rédigé à Qazvin en 969 H, Cheikh Bahaï avait alors 13 ans[8], bien que d’autres sources le disent âgé de 7 ans à son arrivée[9]. Il aurait exprimé un certain malaise vis-à-vis de cette migration forcée et de son intégration à la cour safavide[10].
Après trois années à Ispahan, son père fut invité à Qazvin, capitale safavide, où il devint Sheikh al-Islam. Cheikh Bahaï l’y accompagna et poursuivit ses études religieuses[11]. En 971 H, il se trouvait à Mashhad avec son père[12]. Ce dernier devint plus tard Sheikh al-Islam à Herat, mais Cheikh Bahaï resta à Qazvin, d’où il lui adressa des poèmes en 979 H et 981 H exprimant sa nostalgie[13].
Cheikh Bahaï maîtrisait l’ensemble des sciences traditionnelles de son temps, et se distinguait dans plusieurs d’entre elles de manière exceptionnelle. Il était un érudit reconnu dans le domaine des sciences religieuses et des enseignements islamiques. Dans la chaîne des autorisations (ijāzāt) de transmission du hadith, il est considéré comme l’un des grands traditionnistes imamites du XIᵉ siècle de l’hégire. De nombreuses chaînes de transmission dans les générations récentes remontent à lui, puis à son père, et à travers celui-ci, à Shahid al-Thani.
Selon un autre savant chiite, Murtaḍa Motahhari, Cheikh Bahaï était un savant véritablement exceptionnel. Il avait des compétences dans tous les domaines – littérature, exégèse coranique, mathématiques, jurisprudence, philosophie et sagesse – et il a écrit dans chacun de ces domaines. Toutefois, il rapporte lui-même cette maxime : « J’ai triomphé de tous ceux qui, comme moi, connaissaient toutes les disciplines ; mais j’ai été vaincu par chaque spécialiste dans son domaine propre ». Autrement dit, il possédait des connaissances étendues dans toutes les disciplines, sans pour autant être un spécialiste exclusif d’aucune[14].
Dès l’âge de 25 ans, il s’était profondément investi dans l’exégèse du Coran, qu’il considérait comme la science la plus noble. Parmi ses efforts les plus notables figure son analyse critique de la classification des hadiths par les savants postérieurs. Il tente d’en expliquer l’apparition en la rattachant à plusieurs facteurs : l’écart temporel avec les anciens pieux prédécesseurs (salaf ṣāliḥ), la disparition progressive des ouvrages fondamentaux des uṣūl al-akhbār, ainsi que les risques de confusion entre les traditions fiables et non fiables selon les anciens. Cette difficulté d’accès aux critères d’authenticité a conduit, selon lui, les savants postérieurs à introduire de nouvelles définitions pour des termes comme ṣaḥīḥ (authentique), ḥasan (bon) et muwaththaq (fiable), afin de mieux classer les hadiths. Il discute également des origines de ces divisions chez les anciens et de leur compréhension des catégories traditionnelles.
Outre les sciences islamiques, les domaines de prédilection de Cheikh Bahaï furent les mathématiques, suivies par l’architecture et l’ingénierie. Il possédait également une expertise remarquable en géographie et en astronomie.
En 983 H, son père retourna à Qazvin et demanda au Shah la permission d’accomplir le pèlerinage à La Mecque. Le Shah accepta pour lui, mais refusa que Cheikh Bahaï l’accompagne, l’obligeant à rester à Qazvin pour enseigner[15].
Fonctions religieuses et académiques
Sous le règne de Shah Abbas Ier, Cheikh Bahaï fut nommé Sheikh al-Islam de la cour safavide[16]. Il servit de médiateur entre le pouvoir central et les oulémas chiites, dans un contexte de renforcement idéologique du chiisme duodécimain.
Œuvre et contributions
Ce savant chiite laissa un corpus varié, mêlant sciences religieuses, mathématiques, astronomie, et soufisme. Ses œuvres incluent :
al-Zubda fī uṣūl al-fiqh, traité de jurisprudence
al-Ithnā ʿashariyya, en théologie imamite
Tashrīḥ al-aflāk, en astronomie
Kholāṣat al-ḥisāb, manuel d’arithmétique
Il est également réputé pour ses innovations en architecture (plans de mosquées, système hydraulique d’Ispahan) et pour sa poésie mystique en persan et en arabe[17].
Les œuvres architecturales
Les réalisations architecturales et techniques attribuées à Cheikh Bahaï peuvent être classées, en termes de degré de certitude, en trois catégories principales :
Œuvres dont l’attribution à Cheikh Bahaï est historiquement bien établie Il s’agit notamment de la conception du système de répartition des eaux du Zāyandeh-Rūd entre les sept quartiers d’Ispahan. Les caractéristiques détaillées de ce projet sont consignées dans un document connu sous le nom de Ṭūmār cheikh Bahaï, un rouleau manuscrit explicitant les modalités techniques de cette distribution hydraulique.
Œuvres attribuées à Cheikh Bahaï par certaines sources historiques, bien que leur paternité ne soit pas confirmée de manière irréfutable :
La coupole de la mosquée de l’Imam à Ispahan
La conception du kārīz (canal souterrain) de Najafābād, connu sous le nom de qanāt-e Zarrīn-Kamar
La détermination précise de la direction de la qibla dans la mosquée de l’Imam à Ispahan
Le plan de la muraille de la ville de Najaf
La conception et la réalisation d’un gnomon pour l’heure légale de midi au couchant dans la mosquée de l’Imam, ainsi que dans la cour du sanctuaire de l’Imam Rida (ʿa) à Mashhad
Le tracé d’un dispositif mural dans la cour du sanctuaire de l’Imam Ali (a) à Najaf permettant de déterminer exactement le moment du zénith solaire (zawāl al-shams) tout au long de l’année
La conception de la cour centrale du sanctuaire de Mashhad selon un plan hexagonal régulier
L’invention d’un type de poudre cosmétique blanchissante, connue localement sous le nom de safīdāb-e Sheykh à Ispahan
La construction du célèbre Mināra-jonbān (« minaret oscillant ») d’Ispahan
L’acoustique unique de la coupole de la mosquée de l’Imam, qui permettrait la réflexion du son jusqu’à sept fois
L’invention d’une horloge autonome, ne nécessitant pas de remontage mécanique1
Œuvres dont l’attribution à Cheikh Bahaï est considérée comme légendaire ou hautement improbable, relevant davantage de l’imaginaire populaire ou de l’admiration exagérée pour son génie :
Le célèbre hammam de cheikh Bahaï (bain public de Cheikh Bahaï) à Ispahan, dont on raconte que l’eau y était chauffée pendant longtemps uniquement par la flamme d’une bougie[18].
Pensée et postérité
Cheikh Bahaï fut une figure intellectuelle de synthèse : entre droit, mystique, et sciences rationnelles. Il marqua profondément le développement du chiisme safavide et forma plusieurs disciples influents.
Décès
Quelques jours avant sa mort, cheikh Bahaï se rendit à Ispahan avec un groupe de ses compagnons et étudiants pour visiter le tombeau de Baba Rukn al-Din Shirazi. Il reçut une révélation qui lui permit de déduire que sa mort était proche. Muhammad Taqi Madjlisi[20], l’un des compagnons du cheikh, rapporta cette révélation.
Cheikh Bahaï se retira alors et mourut à Ispahan après une maladie de sept jours. Selon son testament, il fut transféré à Machhad et enterré dans la salle de classe, aux pieds de l’Imam Reza (as).[22]
Dans son Mustadrak Safinat al-Bihar, Namazi situe la mort de cheikh Bahaï au 4 Shawwal de l’an 1029 de l’Hégire[23].
Eskandar Munshi,[24] chroniqueur de Shah Abbas, et Muzaffar ibn Muhammad Qasim Gonabadi, célèbre astrologue de l’époque, dans l‘œuvre Tanbihat al-Manjumin écrite quelques mois après la mort de cheikh Bahaï, mentionnent l’année de la mort de cheikh Bahaï en l’an 1030 AH. Cependant, Nizam al-Din Sawji, son étudiant soutient qu’il serait décédé en 1031 AH0., de nombreux biographes ont soutenu cette thèse.[25]
Conclusion
Cheikh Bahaï se distingue comme une figure emblématique du chiisme, ayant profondément marqué son époque par sa synthèse unique des sciences religieuses, des mathématiques et des arts. Son héritage intellectuel et architectural perdure, témoignant de sa polyvalence et de son influence durable sur la pensée et la pratique chiites. Au-delà de ses contributions académiques, il fut un pilier communautaire et un médiateur politique, façonnant l’identité safavide. Sa vie, empreinte d’une quête constante de savoir et d’une profonde spiritualité, continue d’inspirer, confirmant son statut de savant exceptionnel dont la postérité est vénérée jusqu’à nos jours. Cheikh Bahaï incarne ainsi l’érudit chiite par excellence, dont l’œuvre et la pensée continuent de rayonner à travers les siècles.
Notes
[1] Muḥammad Baqir al-Khwānsārī, Rawḍāt al-Jannāt, vol. 1, p. 96.
[2] Aḥmad ʿAlī Mahdavī Dāmghānī, Ṣafīnat al-Bihār, t. 1, p. 44.
[3] Agha Buzurg Tehrani, al-Dharīʿa ilā Taṣānīf al-Shīʿa, vol. 10, p. 111.
[4] Muḥammad Taqī al-Majlisī, Biḥār al-Anwār, vol. 105, p. 15.
[5] Rasūl Jaʿfarīyān, Tārīkh-e ʿelmī-ye dīnī dar ʿahd-e ṣafavī, Téhéran, Markaz-e Asnād-e Enqelāb-e Eslāmī, 2011.
[6]Abbās Qumī, Muntahā al-Āmāl, vol. 2, p. 484.
[7] Ḥusayn Modarressī, Crisis and Consolidation in the Formative Period of Shiʿite Islam, p. 164.
[8] Manuscrit autographe, Bibliothèque de Qazvin, ms. 1036.
[9] Mīrzā ʿAbd Allāh Afandī, Riyāḍ al-Ulamāʾ, vol. 2, p. 218.
[10] Bahāʾ al-Dīn Muhammad ibn Husayn, Nān wa Ḥalwā, éd. Muḥammad Khānī, p. 42.
[11] Bahāʾ al-Dīn al-ʿĀmilī, Nān wa Ḥalwā, éd. Muḥammad Khānī, p. 45.
[12] Bahāʾ al-Dīn , al Amili, Nān wa Ḥalwā, éd. Muḥammad Khānī, p, p. 48.
[13] Dīvān-i Bahāʾī, éd. Qazvīnī, pp. 132-135.
[14] Muṭahharī, M., Āshnā’ī bā ʿUlūm-e Islāmī, vol. 3, p. 122.
[15] Baha al- Din, Muhammad ibn Husayn, Nān wa Ḥalwā, p. 52.
[16] Ḥasan al-Amīn, Aʿyān al-Shīʿa, vol. 3, p. 218.
[17] M. H. Sharif, A History of Muslim Philosophy, vol. 2, p. 1183.
[18] Aḥmad Tamīm-Dārī, Dānishmandān-e Irānī, 2005, p. 211
[19] Encyclopaedia Islamica, s.v. Bahāʾ al-Dīn al-Āmilī.
[20] Madjlisi, Mohammad Taqi Rudhah, vol. 14, p. 445-447
[21] Afandi Isfahani, Riyadh, vol. 5, p. 97.
[22] Namazi, Mustadrak safinatu al bahar, vol. 6, p. 65.
[23] Namazi, Mustadrak safinatu al bahar, vol. 6, p. 967
[24] Khurasani, Muḥammad Hāshim. Kitāb Muntakhab al-tavārīkh. Téhéran: 1317 H.S., p. 640.
Références
Āqā Buzurg Ṭehrānī. al-Dharīʻah ilá taṣānīf al-Shīʻah. Édité par ʻAlī Naqī Munzavī et Aḥmad Munzavī. Beyrouth: 1403 AH.
Afandī, Mirza Abdullah, Riyāḍ al-ʻulamāʼ wa-ḥiyāḍ al-fuḍalāʼ. Édité par Aḥmad Ḥusaynī. Qom: 1401 AH.
Muḥammad Baqir al-Khwānsārī, Rawḍāt al-Jannāt. 1406 H.L
Muḥammad Taqī al-Majlisī, Biḥār al-Anwār, Beyrouth. 1401 AH.
Rasūl Jaʿfarīyān, Tārīkh-e ʿelmī-ye dīnī dar ʿahd-e ṣafavī, Téhéran, Markaz-e Asnād-e Enqelāb-e Eslāmī, 2011.
Abbās Qumī, Muntahā al-Āmāl, éd. Mubin andisheh. 1390. H.S
Ḥusayn Modarressī, Crisis and Consolidation in the Formative Period of Shiʿite Islam, 2007.
Manuscrit autographe, Bibliothèque de Qazvin, ms. 1036.
Afandi, Mīrzā Abdullah Afandī, Riyāḍ al-Ulamāʾ, Qom, Bibliothèque Ayatolah Marashi, 1401 A.H
Bahāʾ al-Dīn, Muhammad ibn Husayn, Nān wa Ḥalwā, éd. Muḥammad Khānī, édition kitabshin, 1396 H.S
Bahāʾ al-Dīn , Muhammad ibn Husayn, Nān wa Ḥalwā, éd. Muḥammad Khānī, édition kitabshin, 1396 H.S
Bahāʾ al-Dīn,Muhammad ibn Husayn, Nān wa Ḥalwā, éd. Muḥammad Khānī, édition kitabshin, 1396 H.S
Bahāʾ al-Dīn , Muhammad ibn Husayn, Divan-e- Bahāʾī, éd. Qazvīnī, 1384 H.S
Muṭahharī, Murtadha, Āshnā’ī bā ʿUlūm-e Islāmī, éd. Sadro. Téhéran: 1402 H.S
Baha al- Din, Muhammad ibn Husayn, Nān wa Ḥalwā, édité par Muḥammad Khānī, édition kitabshin, 1396 H.S
Ḥasan al-Amīn, Aʿyān al-Shīʿa. Dâru atta’ruf lilmatbuat, Beyrouth: 1403 H.L
M. H. Sharif, A History of Muslim Philosophy, Royal book. 1983.
Aḥmad Tamīm-Dārī, Dānishmandān-e Irānī, Sureh Mehr. 2005.
Encyclopaedia Islamica, s.v. Bahāʾ al-Dīn al-Āmilī. 1988
Madjlisi, Mohammad Taqi, Rudhah, éd. Kushanpur, 1406 H.L
Namazi, Ali Shahrudi, Mustadrak safinatu al bahar, Muasasah atabat, Mashhad: 1404 H.L
Namazi, Mustadrak safinatu al bahar, Muasasah atabat, Mashhad: 1404 H.L
Khurasani, Muḥammad Hāshim. Kitāb Muntakhab al-tavārīkh. Téhéran: 1317 H.S., p. 640.