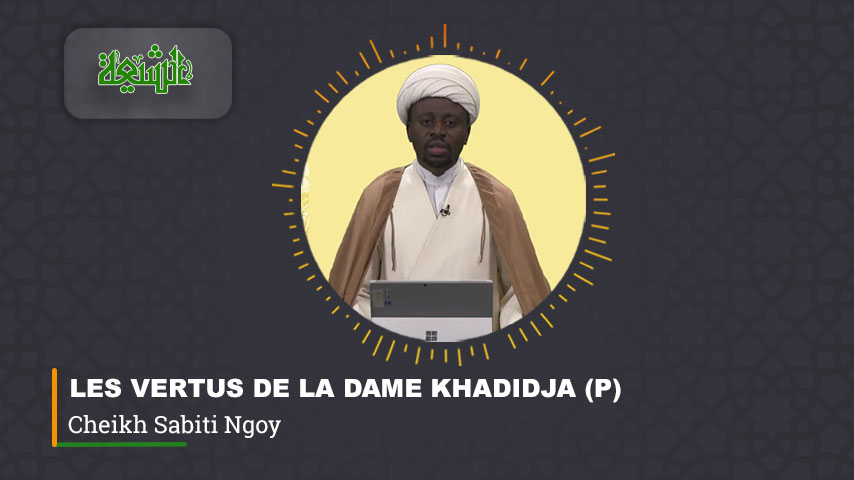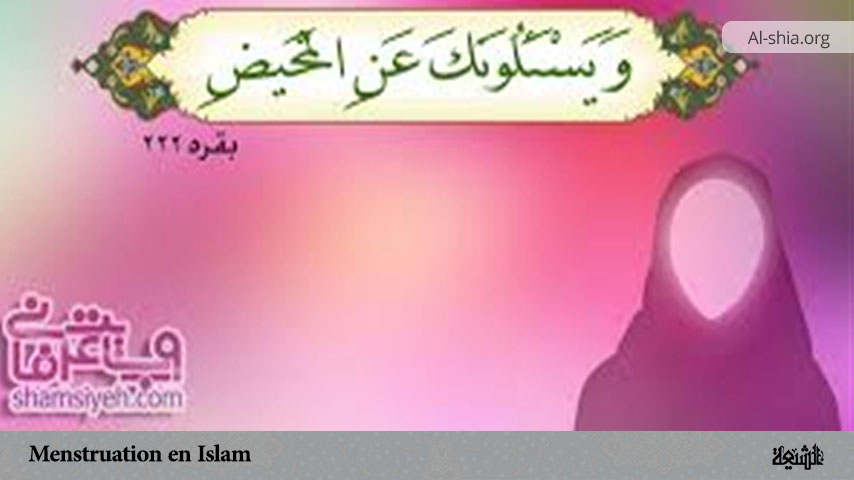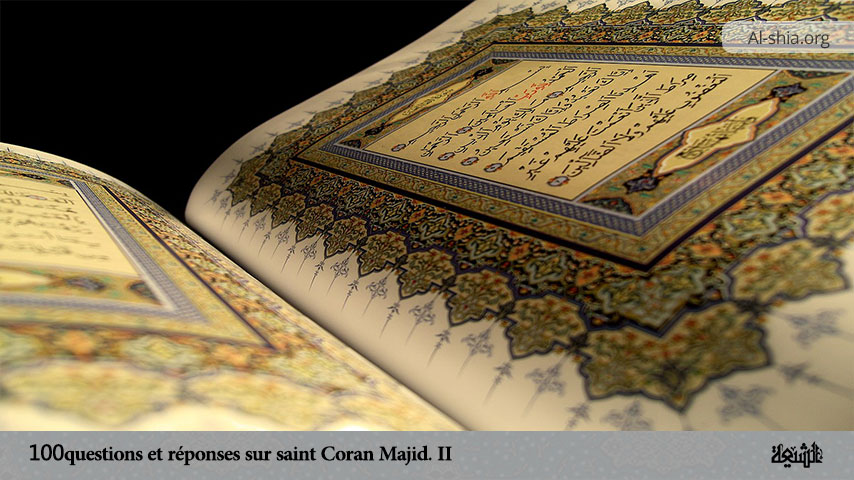L’Arbaïn, le quarantième jour après la tragédie de Karbala où l’Imam Hussein (P), certains membres de Banu Hachim et certains de ses compagnons sont tombés en martyre le jour de Achoura en l’an 61 H qui coïncide avec le 20 Safar du calendrier hégirien, qui correspond à quarante jours après le martyre de l’Imam al-Husayn (P) à Karbala.
Racine historique
L’Arbaïn marque le 40ème jour du martyre vénéré Imam Hussein, prince des martyrs (béni soit-il). La cérémonie d’Arbaïn coïncide avec le 20 du mois de Safar. L’Arbaïn est ancré dans notre culture religieuse. Selon les rapports historiques Jâbir b. Abd Allah al-Ansârî, le compagnon du Prophète de l’Islam (s), avec ‘Atîyya al-‘Awfy, à l’occasion du 40e jour après le martyre de l’Imam al-Husayn (P), étaient les premiers pèlerins à se rendre au tombeau de l’Imam al-Husayn (P) et ont visité la tombe de l’Imam al-Husayn (P).[1]
Selon certaines sources, en plus de Jâbir, les rescapés de la tragédie de Karbala se sont également rendu ce jour à Karbala et ont rendu visite pieuse aux tombes des martyrs[2]. Dans les traditions chiites ce jours est considéré comme très important et une des pratiques particulières et très conseillées de ce jour est la Ziyâra de Arbaïn. Cette pratique est considérée, selon une tradition attribuée à l’Imam Hasan al-Askarî (P), un des signes de Mu’min.
Retour des captifs de la tragédie de Karbala
Captifs de Karbala sont ceux qui, après la tragédie de Karbala et après le martyre de l’Imam al-Husayn (P) et ses compagnons, survécurent et furent emmenés à Koufa et à Cham. Il y a de différents rapports concernant le nombre de ces captifs.
Les personnes les plus connues parmi les captifs furent l’Imam as-Sajjâd (P) et Zaynab bt. Ali (P). Leurs discours devant ‘Ubayd Allah b. Zîyâd et Yazid b. Muawiya eurent beaucoup d’effets sur les gens qui ne savaient pas la vérité de la tragédie de Karbala et les mérites des martyrs. Il existe des divergences parmi les historiens au sujet du retour des captifs de Karbala (les membres de la Sainte famille de Prophète (s), Ahl-ul-bayt (P)) au lieu du drame (Karbala) sur leur chemin vers Médine :
Certains comme Muhaddith an-Nûrî, auteur du livre Lu’lu’ wa al-Marjân[3] et ses disciples dont le Cheikh Abbas al-Qummî, dans son livre, Muntaha al-Âmâl[4] considèrent que non seulement ce retour n’a pas eu lieu cette année-là, mais aussi elle aurait été absolument impossible. Vu la longueur du trajet, la caravane des captifs de Karbala n’aurait pas pu se rendre de Koufa en Syrie et retourner ensuite vers Karbala en espace de seulement 40 jours Arbaïn après le drame. Avant Muhaddith an-Nûrî, c’est Ibn Tawûs qui, dans son livre Iqbâl al-A’mâl, a mis en cause l’idée d’un tel retour sur ces lieux.[5]
Outre la distance géographique importante, les historiens qui ne sont pas d’accord avec cette idée, avancent d’autres arguments dont le manque de document fiable sur ce sujet dans les sources anciennes de l’histoire de l’islam. [6]
Certains auteurs qui ont accepté l’idée du retour des captifs de Karbala (Arbaïn )(de la famille de l’Imam al-Husayn (P)) aux lieux sur le chemin de la Syrie à Médine, estiment que ce retour aurait eu lieu vers la fin du mois de safar ou au début de Rabî’ al-Awwal, voire plus tard, et non pas quarante jours après.(Arbaïn)
D’autres encore considèrent que la visite de la tombe de l’Imam al-Husayn (P) par sa famille se serait effectuée à l’anniversaire de l’Arbaïn des années suivantes.
A l’opposé de ces idées, certains auteurs pensent que la caravane des captifs de Karbala aurait fait un trajet dans un autre sens. C’est à dire qu’elle serait partie de la Syrie vers l’Irak, et serait arrivée à Karbala le jour de Arbaïn (40 jours après la tragédie de Achoura) et après avoir rendu visite à la tombe de l’Imam al-Husayn (P), elle aurait poursuivi son chemin en direction de Médine. C’est l’idée émise dans al-Luhûf d’Ibn Tâwûs, qui souligne que ces membres de Ahl al-Bayt (P) auraient rencontré, au cours de cette visite, Jâbir b. Abd Allah al-Ansârî et certains membres de Banu Hachim.[7]
Les partisans de cette idée ont en général examiné, d’une part, les routes reliant l’Irak et la Syrie et les conditions du transport à l’époque, et d’autre part les témoignages historiques sur la période où la caravane a eu des scales à Koufa et en Syrie, admettant la possibilité de son retour à Karbala durant Arbaïn.
Ils avancent ainsi des arguments pour prouver les récits selon lesquels la famille de l’Imam al-Husayn (P) s’est rendue à Karbala lors de Arbaïn de l’an 61 H.[8] Parmi les livres importants, écrits en confirmation de cette idée et en réponse aux opposants, on peut citer Recherches sur le premier Arbaïn du Seigneur des martyrs écrit par Sayyid Muhammad Ali Qâdî Tabâtabâ’î.
L’importance
L’importance du chiffre quarante Arbaïn
En arabe, le mot « Arbaïn » signifie « quarante ». Dans un contexte religieux, il correspond au dernier jour d’une période de quarante jours – pour l’Arbaïn dont nous parlons, il s’agit de la période allant du 10 Muharram au 20 Safar. Comme nous l’avons évoqué, le jour de l’Arbaïn a une place particulière dans le calendrier religieux chiite car après l’Ashourâ, c’est la deuxième date importante de rassemblement pour les chiites pour se rassembler de nouveau afin de commémorer les souffrances de la famille de l’Imâm Hussein capturée après la bataille. Les fidèles y commémorent donc également la force spirituelle, le courage et le sacrifice inégalé d’une femme, Zaynab, sœur de l’Imâm Hussein, qui va porter le message de l’événement de Karbala à la postérité, avec son neveu l’Imâm Ali Zayn al-Abédin al-Sajjâd, 4e Imâm des chiites.
L’importance de l’Arbaïn:
L’Arbaïn, qui marque le quarantième jour après l’Achoura, est une commémoration importante dans le chiisme, commémorant le martyre de l’Imam Hussein à Karbala. Il est considéré comme un événement majeur, attirant des millions de pèlerins à Karbala, en Irak, pour rendre hommage à l’Imam Hussein.
Les imams d’Ahlul bayt ont encouragé leurs fidèles à ce pèlerinage. Leurs paroles ont persuadé les musulmans chiites de se rendre à Karbala le jour d’Arbaïn pour faire un pèlerinage au sanctuaire de l’Imam Hussein (P). La tradition du pèlerinage d’Arbaïn s’est poursuivie jusqu’à nos jours. Au jour de l’Arbaïn, les fidèles récitent la prière de visitation de l’Arbaïn afin de renouveler l’allégeance promise à l’Imâm Hussein le jour de l’Ashourâ. L’Imâm Hassan al-‘Askari, onzième Imâm des chiites duodécimains, évoque que cinq signes permettent de reconnaître un vrai fidèle : réaliser 51 rak’ats de prières chaque jour ; porter une bague à la main droite ; prononcer de manière intelligible et claire « Bismi-llAhi r-Rahmani r-Rahimi » (Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux) durant les prières ; se prosterner devant Dieu en posant le front sur la terre – de préférence celle de Karbala –, et enfin effectuer une visite pieuse à l’Imâm Hussein à l’occasion de l’Arbaïn. .[9] On rapporte de l’Imam Baqir (P):
«Ordonnez à nos partisans de visiter le tombeau de l’Imam al-Hussein (P) car sa visite augmente la subsistance, la durée de vie et écarte les malheurs » .[10]
On rapporte de l’Imam as-Sãdiq (P):
« Quiconque visite l’Imam Hussein (P) tout en connaissant son droit et en acceptant sa guidance, Dieu pureté à lui, lui pardonne ses pêchés passés et à venir » .[11]
On rapporte de l’Imam as-Sãdiq (P):
«Certes les jours de visite des visiteurs de Hussein ibn Ali (P) ne se décomptent pas de leur durée de vie et ne sont pas considérés dans leur longévité » .[12]
On rapporte de l’Imam al-Hussein (P):
« Quiconque visite (ma tombe) durant sa vie, je me rend auprès de lui après sa mort » .[13]
On rapporte de l’Imam Sãdiq paix sur lui: «si les gens savaient combien de bonnes choses se trouvent dans la visite de l’Imam Hussayn paix sur lui, ils s’entretueraient pour le visiter et vendraient le moindre bien qu’ils possèdent afin de pouvoir aller le visiter » [14] Abdullah ibn Ubayd Anbari rapporte qu’il dit à l’Imam Sãdiq paix sur lui: «que je te sois sacrifié, il ne m’est guère possible d’aller faire le pèlerinage tous les ans ». Il dit : « quand tu as l’intention de faire le pèlerinage alors que tu n’en as pas les moyens, va rendre visite au tombeau de l’Imam Husayn paix sur lui de telle façon qu’un pèlerinage sera écrit à ton compte » [15]
On rapporte de l’Imam Sãdiq paix sur lui: «N’est-il pas que Fatima paix sur elle la fille de Mohammad paix sur lui et sa pure famille viennent auprès des visiteurs du tombeau de son fils Husayn paix sur lui et demande le pardon à Dieu pour leurs pêchés » [16] On rapporte que l’Imam Sãdiq paix sur lui dit à Abd al-Malik Khut’ami: «N’abandonne pas la visite de Husayn ibn Ali paix sur lui et enjoins tes amis à le faire afin que Dieu allonge ta durée de vie et accroisse ta subsistance, qu’il fasse de ta vie une vie heureuse et que tu ne meurs qu’heureux et que Dieu t’inscrive sur le chemin des heureux » [17]
La visite de l’Imam Hussein (P)
Zîyârat al-Arbaïn
La visite de l’Imam Hussein (P) à Arbaïn est d’une grande importance dans le chiisme, marquant la fin du deuil de 40 jours Arbaïn après l’Achoura (martyre de l’Imam Hussein à Karbala). C’est un pèlerinage massif, le plus grand au monde, où les fidèles se rendent à Karbala pour commémorer le sacrifice de l’Imam Hussein et exprimer leur amour pour lui.
Ziyârah signifie en arabe visite au sens propre et courant de ce mot. Mais en tant que terme technique islamique on désigne sous ce vocable le fait de se rendre aux mausolées ou tombes des saints de l’Islam (le noble Prophète et les membres bénis de sa famille et de sa descendance, les Ahl-ul-Bayt) pour se rapprocher d’Allah en présentant les salutations dues à Ses élus, en confirmant et renouvelant la fidélité à leur cause (la Cause d’Allah) et l’hostilité envers leurs ennemis et détracteurs (les ennemis d’Allah), et ce selon des rites prescrits. Cette visite pieuse comporte entre autres et essentiellement la lecture de textes prescrits par les Imams d’Ahl-ul-Bayt (p) eux-mêmes.
Invitation à la zîyârat d’Arbaïn
Le jour d’ Arbaïn du Seigneur des Martyrs (Le quarantième jour du martyre de Sayyid ash-Shuhadâ, l’Imam Husayn (P)) est conforme au vingtième jour du mois de Safar.
Ach-Cheikh at-Tûsî a rapporté de l’Imam al-Hasan al-‘Askarî (P) dans le livre de Tahzîb : les signes de Mu’min (croyant ou initié des enseignements des Imams) sont cinq : de faire 51 rak’ats de prière par jour (24 heure) dont 17 rak’ats de prières obligatoires journalières et 34 rak’ats de nâfila (prière conseillée et non-obligatoire), d’effectuer le zîyârat d’ Arbaïn,
de mettre une bague dans la main droite, de mettre le front au sol (la prosternation), de prononcer le «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم» à voix haute [18].
Procession d’Arbaïn
Les chiites, à travers le monde entier, et notamment les chiites de l’Irak, effectuent chaque année à l’occasion d’ Arbaïn, une marche rituelle qui fait partie des plus grandes processions au monde. À ce propos, on peut préciser que l’année dernière (2013-1392 H.S.-1435 H.L.) autour de 15 millions de personnes avaient participé à cet événement.
Qâzî Tabâtabâï écrit que le départ vers Karbala au jour de Arbaïn était courant parmi les chiites depuis l’époque des Imams. Les chiites exigeaient cette marche également à l’époque des Umayyades ainsi qu’à l’époque des Abbassides.
Conclusion
En conclusion, nous pouvons affirmer qu’Arbaïn coïncide avec le 20 Safar du calendrier hégirien. C’est le quarantième jour après la tragédie de Karbala où l’Imam al-Husayn (P) et ses compagnons ont été tués en martyre le jour de Achoura de l’an 61
L’Arbaïn est un événement central pour les musulmans chiites, symbolisant leur engagement envers les enseignements de l’Imam Hussein (P) et leur résistance à l’injustice. Il rappelle la nécessité de se battre pour la justice, la liberté et les valeurs morales.
La bataille était inégale; Imam et ses 72 disciples, privés de nourriture et d’eau, en face d’environ 70.000 soldats Yazid. Imam Hussein (P) et ses partisans sont tombés martyrs.
Références
1-Al-Qummî, Safînat al-Bihâr, vol 8, p 383, 1414 H
2-Ibn Tâwûs, al-Luhûf, p 225, 1414 H
3-An-Nûrî, Lu’lu’ wa al-Marjân, p 208-209
4-Al-Qummî, Muntaha al-Âmâl, p 524-525
5-Ibn Tâwûs, Iqbâl al A’mâl, vol 2, p 589
6-Subhâninîyâ, tout l’article, Ranjbar, Pazhûhishî dar Arba’în Husaynî, p 168-172
7-Ibn Tâwûs, al-Luhûf, p 225
8-Ranjbar, Pazhûhishî dar Arba’în Husaynî, p 172-187 ; Fâzil, Tahlîl Mabânî Târîkhî Arbaïn Hussaynî
9-Al-Mazār al-kabīr, p 353; wasāʾil al-shīʿa , vol 14, p 478 ;Ibn Tâwûs, Iqbâl al A’mâl, vol 3, p 100
10- Al-Qummî, Ibn Quliwayh, Kâmil az-Zîyârât, p.289
11- Usul al-Kafi, t.4, p.582.
12- wasāʾil al-shīʿa , vol 10, p 322
13- Bihar, Allama Majlisi, t.101, p.16.
14- Al-Qummî, Ibn Quliwayh, Kâmil az-Zîyârât, p.87.
15- Al-Qummî, Ibn Quliwayh, Kâmil az-Zîyârât, p.306.
16- Extraits du Complet des visites de Ibn Quluyeh, p.204.
17- Al-Qummî, Ibn Quliwayh, Kâmil az-Zîyârât, p.292
18-Cheikh at-Tûsî, Tazhîb al-Ahkâm, vol 6, p 52
Bibliographie
- Abū ʿAbd Allāh Muḥammad b. Jaʿfar b. ʿAlī al-Mashhadī al-Ḥāʾirī, Al-Mazār al-kabīr, première édition 1419 AH, Qom, Iran
- Fâzil, Muhammad, Tahlîl Mabânî Târîkhî Arbaïn Hussaynî, revue Rawâq Andîshih, mai et juin 1380, n. 1
- Ibn Qūlawayh (Qūlūya), Abu’l-Qasem Ja’Far b. Moḥammad b. Jaʿfar b. Mūsāb. Qūlawayh Qomī Baḡdādī, Kâmil az-Zîyârât, p 4, Nadjaf, Dâr al-Murtadawîyya, 1356 H
- Ibn Tâwûs, ‘Alî b. Mûsâ, Al Malhûf ‘alâ Qatl il Tufûf, Uswa, Qum, 1414 de l’hégire lunaire
- Ibn Tâwûs, ‘Alî b. Mûsâ, Iqbâl al A’mâl, Dar al Kutub al Islâmiya, Téhéran, 1367 de l’hégire solaire
- Kuleïni, Muhammad bin Yaqub, Al-Kafi, Daral-Kutub al-Islamiah, Téhéran 1388 hégire.
- Majlisî, Muhammad Bâqir ibn Muhammad Taqî, Bihâr al-Anwâr, recherche par ‘Alî Akbar Ghaffârî et d’autres, Beyrouth, Dâr Ihyâ’ at-Turâth al-‘Arabî, 1386 sh – 1403 h.
- Muhammad b. al-Hasan b. ‘Ali b. al-Husayn al-‘Amili (b.1033/1624 – d.1104/1693), commonly known as Al-Hurr al-‘Amili,Tafṣīl wasāʾil al-shīʿa ilā taḥṣīl masāʾil al-sharīʿa, Qom: Muʾassisat Āl al-Bayt, 1414 AH.
- Nûrî, Mîrzâ Hussayn, Lo’lo’ wa Marjân, Nashr Afâq, Téhéran, 1388
- Qâzî Tabâtabâï, Sayad Muhammad ‘Alî, Tahqîq darbariyi Arbaïn Hazrat Sayad al Shohadâ (AS), Bonyâd ‘Ilmî wa Farhangî Shahîd Ayatolâh Qâzî Tabâtabâï, Qum, 1368 de l’hégire solaire
- Qumî, ‘Abbas, Muntahî al Amâl, Matbû’âtî Hussaynî, Téhéran, 1372
- Qumî, ‘Abbas, Safînat al Bihâr, Nashr Uswi, Qûm, 1414 de l’hégire lunaire
- Ranjbar, Muhsin, Pajûhishî dar Arbaïn Hussaynî, revue « Târîkh dar Aïnih Pajûhish », printemps 1384, n. 5
- Seyed Radî al-Dîn, ‘Ali ibn Mûsâ b ibn Ja’far b. Tâwûs, Al-Lohoof, Intesharat Sharif Radi, Qum
- Subhânî-Niya, Muhammad Taqî, Tahqîqî darbariyi Arbaïn Hussaynî, revue « Târîkh dar Aïnih Pajûhish », été 1384, n. 6
- Tûsî, Muhammad b. al Hasan, Tahdhîb al Ahkâm, Dar al Kutub al Islâmiya, Téhéran, 1407 de l’hégire lunaire