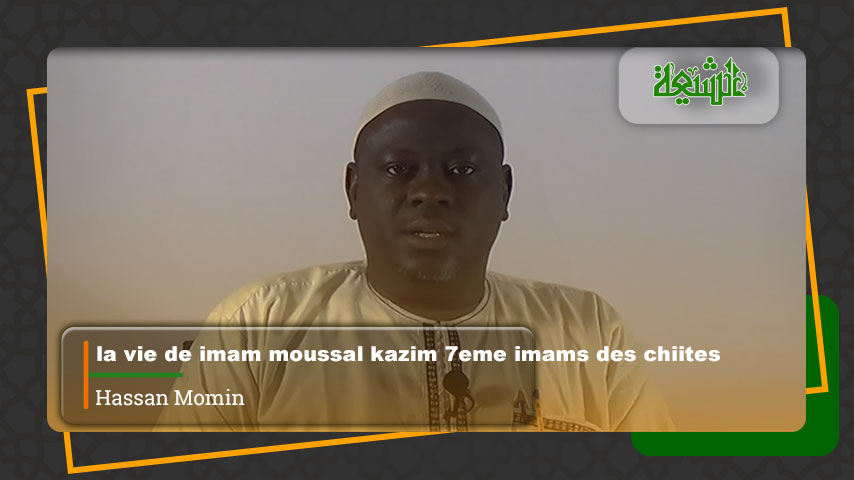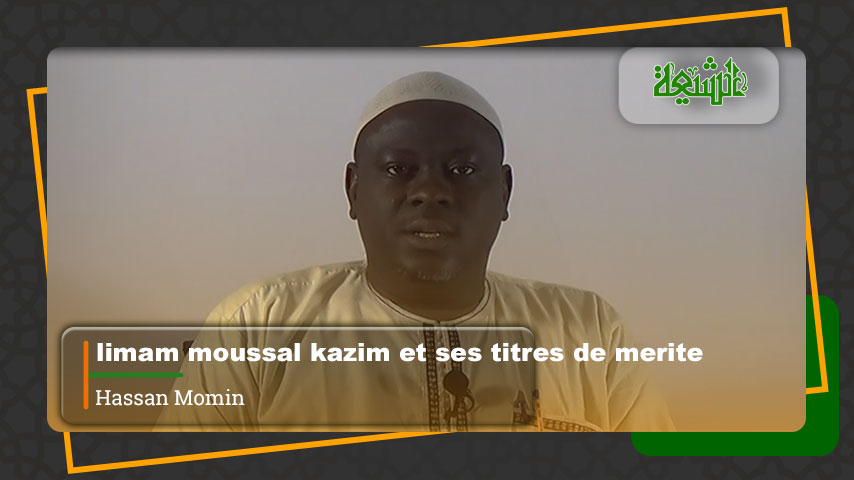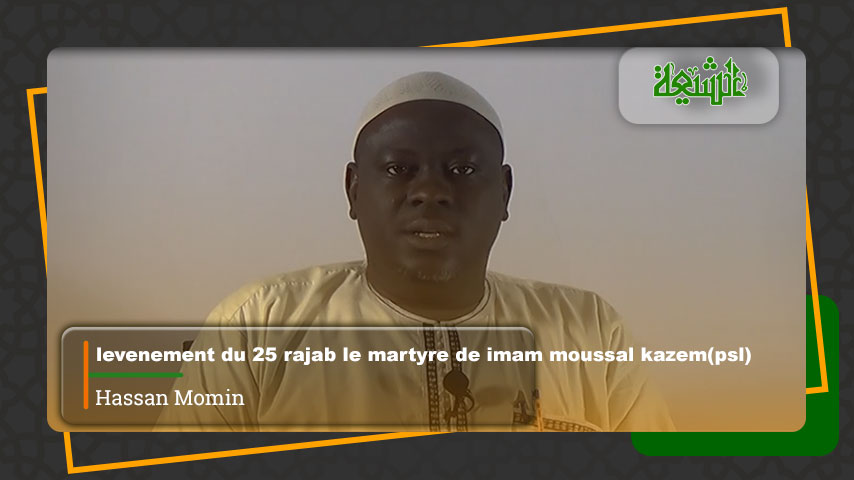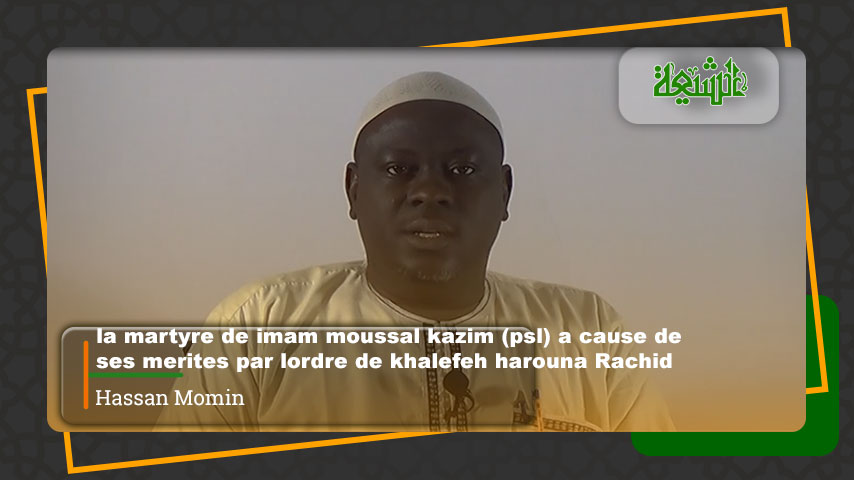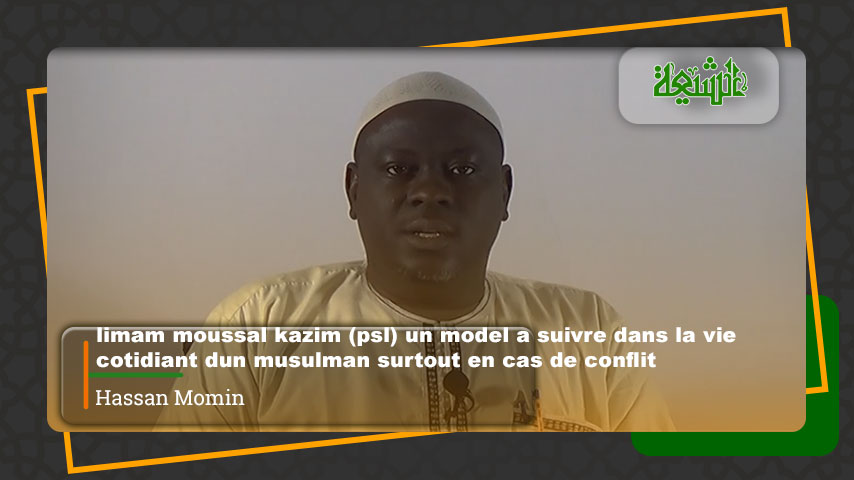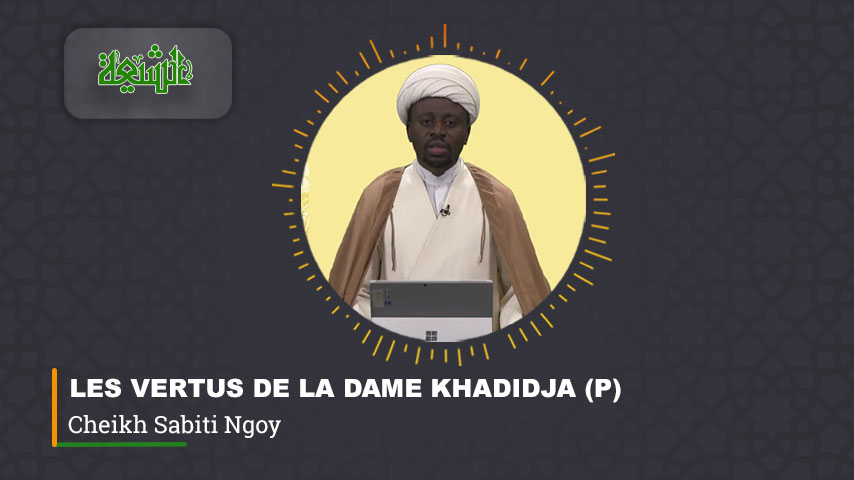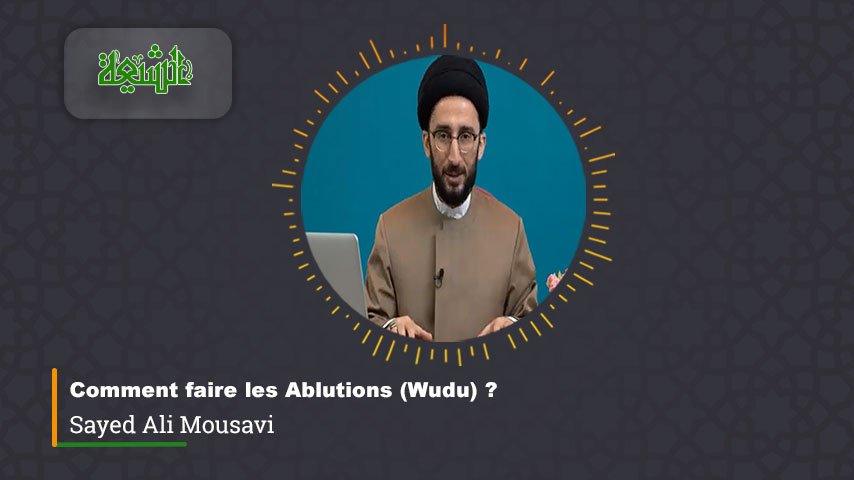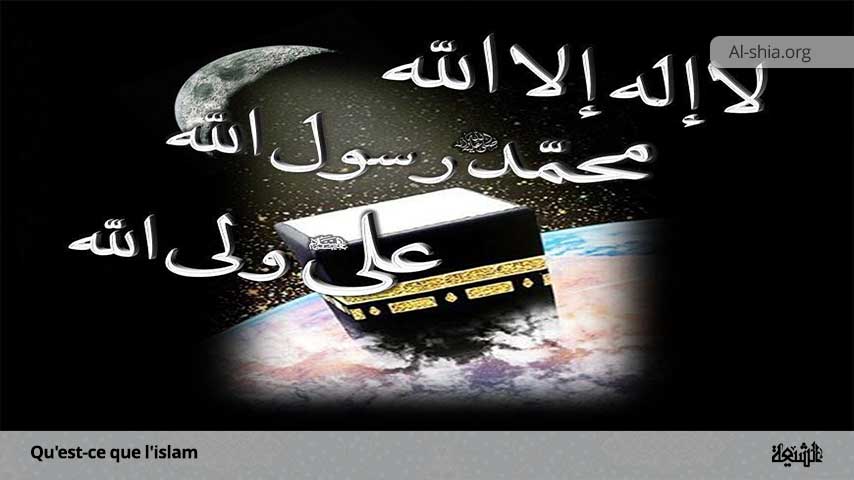La retraite spirituelle à travers la pensée du soufi iranien ‘Abd al-Qâdir al-Jîlânî (m. 561/1166) D’après son manuscrit non identifié « Risâla fî l-khalwa »
Dr. Samir Staali
Introduction
Le présent article vise à cerner les multiples sens de la « retraite spirituelle », désignée dans le monde musulman de façon générale par le terme arabe « khalwa ». De nombreux chercheurs se sont montrés hésitants et ont le plus souvent reculé devant les difficultés inhérentes à ce type d’étude, mettant en jeu non seulement un concept et l’histoire de son évolution, mais aussi et surtout une pratique expérimentale qui touche aux domaines les plus intimes de la spiritualité des individus. C’est sans doute pour cette raison que l’on ne dispose jusqu’à présent que d’informations très fragmentaires sur un sujet pourtant fondamental pour la connaissance de la pensée mystique arabo-musulmane, aussi bien ancienne que contemporaine. Un grand nombre de mystiques ont pour principe, précisément, d’éviter de divulguer les contenus de leurs expériences spirituelles pour diverses raisons, la plus importante étant la crainte de la dévaloriser en la mettant à la portée de tous. Les conséquences d’une telle attitude, décrites en détail par les anciens maîtres, sont selon eux, d’une part la perte a posteriori des bénéfices spirituels de cette pratique par celui qui « parle trop » et risque de tomber ainsi dans les pièges de la vanité, d’autre part le danger a priori pour ceux qui reçoivent une information court-circuitant en quelque sorte les bienfaits d’une initiation progressive et adaptée à la situation de chacun. Le grand soufi iranien al-Jîlânî a bien choisi d’en parler dans un de ses livres qui est resté longtemps inconnu comme nous allons le découvrir.
Dans un premier temps, et avant même d’aborder la complexité et l’originalité caractérisant ce rituel mystique « al-khalwa », et de voir aussi quel sera le rapport entre l’ouvrage de Jîlânî avec ce fameux manuscrit totalement inconnu et qui porte le titre de Risâla fî l-khalwa, nous tenons à parler tout d’abord des sources nous permettant de découvrir un tel arsenal d’archives resté, à nos jours, majoritairement inexploité. Une récente étude menée par deux chercheurs a montré que le nombre des archives arabes demeure très limité, en comparaison avec les autres pays. À leur connaissance, il n’existe que 20 archives ouvertes qui ont été recensées, et parmi elles, douze seulement sont accessibles, la qualité et la fiabilité de ces documents restant à vérifier. [1] Le tableau dressé pour répartir les archives ouvertes par pays montre que l’Égypte vient en première position avec huit AO (Archives Ouvertes), suivie par l’Arabie Saoudite avec cinq AO, mais seulement deux AO sont recensées dans les pays du Maghreb, une en Algérie [2] et une autre en Tunisie. Nous constatons que l’implication de ces pays reste importante dans le monde arabe même si elle est insuffisante.
Parmi l’ensemble des archives ouvertes examinées au cours d’une recherche que nous avons porté sur le sujet de la khalwa (retraite spirituelle), uniquement trois peuvent être considérées comme bibliothèque numérique, le reste ne serait que des archives institutionnelles. Il s’agit de :
- La Bibliothèque d’Alexandrie DAR (Digital Assets Repository) renfermant des documents numérisés tombés dans le domaine public. Cette bibliothèque demeure la seule dans le monde arabe qui dispose d’une archive ouverte renfermant 220 230 documents numérisés,
[3] - L’université d’Alger, composée de documents anciens numérisés et de l’archive Makhtota [4]comptant entre 11 000 et 14 000 documents,
- L’université du Roi Saoud contenant des manuscrits arabes principalement numérisés.
Avant d’exposer notre découverte au sujet d’un manuscrit inconnu retrouvé dans l’une de ces AO, il est bon de dire que tous les documents acquis par ces bibliothèques citées ci-dessus ont fait l’objet d’un traitement documentaire par des responsables : chaque document est doté d’une fiche d’identification, avec les renseignements suivants : auteur, titre, type de support, nombre de pages, etc. Une collection très précieuse de manuscrits relatifs à notre domaine de recherche « Soufisme et jurisprudence islamique » a été mise en place. De plus, les quelques rares manuscrits qui sont regroupés et répertoriés dans des catalogues sont microfilmés et peuvent être commandés auprès des services de la bibliothèque. L’accès aux collections d’ouvrages est libre à travers le site Internet de ces universités. De ce fait, l’amélioration de la qualité et la quantité de ces archives contribuera certainement à l’évolution de la recherche scientifique dans le monde arabo-musulman. Ce libre accès permet à toute personne de : « lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces travaux, ou encore s’en servir à toute autre fin légale, sans barrière financière, légale ou technique autre que celles indissociables de l’accès et l’utilisation d’Internet »
[5].
Présentation des manuscrits :
Dans une étude sur le sujet de la khalwa, nous nous sommes penchés sur l’étude de trois manuscrits, dont les deux premiers sont encore totalement inédits. Ces trois manuscrits sont :
- Muhammad Zayn al-‘Âbidîn Al-Ghamrî (m. 965/1558), al-Jalwa fî bayân aqsâm al-kashf wa l-‘uzla wa-l-khalwa
[6], transcrit par Muhammad Sabt al-Marsifî, Manuscrit n° 2-258, Université Umm al-Qura, La Mecque. [7]
Écrit par Muhammad Zayn al-‘Âbidîn al-Ghamrî, connu aussi par Muhammad Sabt al-Marsifî, ce premier manuscrit de l’Université Umm al-Qura (Arabie Saoudite) est enregistré sous le n° 2-258. On découvre que cette bibliothèque recèle de véritables trésors concernant l’héritage littéraire mystique. À l’origine, concernant notre manuscrit étudié partiellement, il existe un seul recueil composé de deux parties. Pour la première partie, elle contient Risâla fî ahkâm al-samâ’ [8](Traité sur les règles de l’audition spirituelle), mais la « digital library » (al-maktaba l-raqmiyya) de l’Université a répertorié cette première partie grâce à son titre complet al-Ajwiba l-muskata ‘an masâ’il al-samâ’ al-mubhata
[9]. Ce texte qui occupe les folios 1a-10b, est présenté sous le numéro 1-258. Par ailleurs, dans la deuxième partie du recueil, figure une autre œuvre du même auteur Zayn al-‘Âbidîn al-Ghamrî (10e H). Il s’agit de notre manuscrit en question intitulé, Kitâb al-Jalwa fî bayân aqsâm al-kashf wa l-‘uzla wa l-khalwa (Livre de la sortie de retraite pour démontrer les classements du dévoilement, de l’isolement et de la retraite). En effet, ce texte occupe les folios 11a-16a qui sont tous répertoriés sous le numéro de 2-258.
En conclusion, pour résumer ce cahier : le manuscrit est composé de deux parties : 1) ff. 1-10 : Risâla fî ahkâm al-samâ’ (voir fig. 1). 2) ff. 11-16 : Kitâb al-jalwa (voir fig. 2). La dimension n’est pas indiquée et tous les feuillets du manuscrit sont composés, en moyenne, de vingt-et-une lignes par page. Les deux livres qui composent le manuscrit, sont de provenance égyptienne. La première date du 17 Dhû l-Hijja 989 (12/01/1582). L’auteur Zayn al-‘Âbidîn al-Ghamrî n’est pas le scripteur (nâsikh) du manuscrit. Le propriétaire de ce manuscrit est Muhammad ‘Alî Ibn Tâhir al-Watrî. (Figure 1)-(Figure 2)
Dans cette deuxième partie du manuscrit, les différentes acceptions de la notion de khalwa sont abordées. Il existe, globalement, deux types de classement. Tout d’abord, l’auteur nous parle de deux genres de khalwa : la retraite exotérique (khalwa zâhiriyya) appartenant aux disciples débutants et la retraite ésotérique (khalwa bâtiniyya) appartenant aux disciples arrivés à Dieu. Par ailleurs, le second type de khalwa se subdivise à son tour en trois catégories : i) khalwat al-‘ârif (la retraite du connaissant) ii) khalwat al-muhaqqiq (la retraite du cheminant) iii) khalwat al-sâlik (la retraite du mystique réalisé). Ce classement a été établi, dans un premier temps, par Mustafâ al-Bikrî al-Khalwâtî (12e H) dans K. Hadiyyat al-ahbâb fîmâ li-l-khalwa min al-shurûf wa l-âdâb, repris un siècle après, par le shaykh Ahmad al-Tîjânî (13e H). En terme de durée, cette pratique peut s’étaler sur un laps de temps variant de 3 à 40 jours, jusqu’à, dans certains cas particuliers, des durées de une à cinq années.
- Auteur inconnu, Kitâb fî l-tasawwuf ‘alâ l-tarîqa l-Shâdhuliyya [10], 11e /17e, Manuscrit n° 4015, Bibliothèque d’Alexandrie, Alexandrie.
En ce qui concerne le deuxième manuscrit (voir fig. 3) dont le titre peut être traduit par « Le livre de la pratique du soufisme selon la voie Shâdhulî », il figure dans le corpus de la bibliothèque d’Alexandrie, sous le numéro 4015. Le livre se compose de 35 feuillets mais lors des diverses manipulations subies par le manuscrit, ce dernier, selon la fiche descriptive, a perdu quelques feuillets à son début ainsi qu’au milieu et à la fin. Cependant, il existe une marque très utile pour assurer le bon ordre du texte ; il s’agit de la réclame qui nous a conduits à procéder à une analyse détaillée et individuelle des feuillets pour vérifier avec soin le bon ordre tout en relevant les fautes ou les manques éventuels dans ce manuscrit. Nous avons constaté une rupture de lecture à partir du f19a, car la réclame de f18b « yaqûlu » (il dit) n’a pas été reprise dans le f19a qui commence par : « hâdhâ l-kalâm » (cette parole). La dimension d’un feuillet est de l’ordre de 22 sur 16,5 centimètres, avec en moyenne, vingt-et-une lignes par page. Le manuscrit manque de précisions quant au nom de l’auteur aussi bien que celui du copiste. Selon les indications portées sur le recto du premier feuillet, le manuscrit date du 11e siècle de l’hégire (17e). Dans le cas où son écriture, un naskhî, est associée à d’autres éléments contenus dans notre manuscrit, il est possible de situer le lieu de son origine bien que les informations obtenues ne soient pas immédiates et précises pour aboutir à une hypothèse vraisemblable. Cette copie est, en effet, de provenance égyptienne. [11]
3.Auteur inconnu, Risâla fî l-khalwa
[12], transcrit par Zuhayr Sabr Ibn Mustafâ, 1214/1799, Manuscrit n° 7547 / Qâf 521595, Université du Roi Saoud, Riyad. (Figure 4)
Identification du manuscrit
« Risâla fî l-khalwa » :
Le manuscrit (voir fig. 4) est un cahier [13] composé de 7 feuillets, contenant en moyenne vingt et une lignes par page. La première page n’est pas lisible ; par contre, la page suivante commence par « Bismi Llâh al-Rahman al-Rahîm » (Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux). L’écriture est un naskhî [14] avec des points diacritiques et la dimension des feuillets n’est pas indiquée. Le nom du copiste figure uniquement sur la fiche du manuscrit ; il s’agit de Zuhayr Sabr Mustafâ qui a transcrit le manuscrit en l’an 1214 de l’hégire (1799 ap. J-C.). La lecture de ce manuscrit, sur lequel nous avons effectué presque tout le travail, n’ayant eu que très tardivement accès au texte imprimé, est d’un abord difficile dans la mesure où les lettres arabes sont dépourvues des points diacritiques et de voyelles. Le lecteur attentif retrouvera facilement la pensée d’un auteur très initié dans la Voie. En plus, ce manuscrit ne traduit aucune indication susceptible de nous aider à l’identifier. Tout d’abord, le manuscrit ne comporte aucun nom d’auteur. De plus, il n’existe aucune indication qui pourrait permettre d’identifier son origine avant qu’il n’ait été placé en conservation à la Bibliothèque de l’Université du Roi Saoud [15], comme le mentionne le feuillet de garde. D’autre part, la date tardive de la copie (13e H /19e siècle), dont l’auteur est au demeurant inconnu pour le public, ne facilite pas non plus la tâche. Cependant, le style littéraire semble être très ancien et très soutenu. En effet, dès que nous avons abordé le texte pour la première fois, nous n’avons eu aucun doute sur le fait que l’encre de ce savant ne pouvait couler que de la plume d’un grand maître très avancé dans la Voie.
Il semble être intéressant de souligner que dès le début de notre travail, nous nous sommes basés sur ce manuscrit, même en l’absence de l’identité du véritable auteur. Nous avons donc mené une minutieuse enquête pour pouvoir l’identifier et surtout le situer dans le temps. Nous avons recouru pour cela à l’étude des caractéristiques internes du cahier, afin de déterminer son origine. Nous avons procédé à la retranscription de la première partie du manuscrit, pour mener une recherche d’identification via internet et celle-ci nous a conduit jusqu’aux shaykh(s) de la tarîqa l-Qâdiriyya [16] l-‘Aliyya d’Alep (Syrie), qui attribuent ce manuscrit au shaykh fondateur de la tarîqa, shaykh ‘Abd al-Qâdir al-Jîlânî ; ce texte aurait donc fait partie intégrante d’un cours enseigné aux murîd(s) (disciples). C’est notamment le cas pour le shaykh syrien Mukhlif al-‘Alî Ibn Yahyâ al-Hudhayfî al-Qâdirî, qui enseigna les principes de la khalwa selon ce texte. Trois hypothèses viennent à l’esprit ; il peut s’agir d’une appropriation de ce texte par la voie soufie, dans une optique de renforcement de la position de ces shaykhs et afin d’asseoir leur légitimité dans le domaine de la pratique de la retraite spirituelle. Il peut s’agir également d’un traité écrit par l’un des disciples de cette tarîqa ou bien enfin ce serait le shaykh Jîlânî en personne qui serait l’auteur authentique de cette œuvre mystique consacrée à la khalwa.
L’enquête menée sur ce manuscrit portant le nom de Risâla fî l-khalwa (Traité de la retraite spirituelle) répertorié comme un texte anonyme par l’Université du Roi Saoud, nous a permis de confirmer avec assez de certitude qu’il est effectivement une œuvre attribuée au grand maître du soufisme ‘Abd al-Qâdir al-Jîlânî (6e H). Il s’agit, plus précisément, de son œuvre al–Tarîq ilâ Llâh : kitâb ‘an al-khalwa wa l-bay’a wa l-asmâ al-sab’a (Le chemin vers Dieu. Un livre sur la retraite spirituelle, l’allégeance et les sept Noms divins) qu’il a écrit après avoir expérimenté la khalwa à multiples reprises comme nous allons le voir. L’acquisition d’une copie de ce Kitâb pour une analyse comparative entre l’œuvre [17] du maître et le manuscrit, nous a pleinement permis de valider notre hypothèse émise et son authenticité. L’ouvrage du maître reste rare dans les bibliothèques et les librairies et cette rareté est la principale raison qui nous avait empêchés de nous en servir directement comme source d’information dans le cadre de cette recherche. Il faut savoir aussi que cet ouvrage n’a pas été traduit vers des langues occidentales, notre article propose donc une traduction inédite vers le français à partir de la version arabe. Nous espérons que la présentation ainsi que la traduction de ce nouveau traité, dont nous avons pu toucher du doigt le fait qu’il est pratiquement inconnu, même dans les milieux spécialisés, permettra d’enrichir et d’élargir la connaissance de la pratique de la khalwa, en attirant l’attention sur certains points qui, dans la littérature soufie, sont restés, peut être pendant trop longtemps, dans l’ombre.
L’expérience de Jîlânî avec la khalwa :
Parmi l’un des nombreux soufis qui ont consacré à la notion de khalwa (retraite spirituelle) une petite partie dans leurs livres représentant le soufisme dans ses débuts et apportent une lumière sur des problèmes concrets de la spiritualité, nous citons Isfarâyînî (5e H). Selon lui, la khalwa est à la fois un accomplissement de la voie mystique et aussi de la religion pratique, « La khalwa est la mine de la Connaissance et le capital de l’Amour », dit-il dans son K. Kâshif al-asrâr (Le révélateur des mystères). Il est important de souligner que la khalwa a fait objet d’une liste de thèmes abordés dans la partie centrale du K. al–Risâla al-Qushayriyya, écrit par le célèbre soufi iranien Qushayrî (5e H). Ce thème de khalwa, objet chez Qushayrî d’un seul chapitre qui associe la notion de khalwa et celle de ‘uzla, se divise chez Ibn ‘Arabî (7e H), en six chapitres : deux sur la « khalwa » (retraite spirituelle), deux sur la « ‘uzla » (isolement) et deux sur le « firâr » (la fuite vers Allâh). Il a été le premier à avoir associé le terme de « firâr » à la notion de « khlawa », idée qu’il a certainement puisée dans le verset coranique suivant : « Fuyez auprès de Dieu ! (fa-firrû) Oui, je suis pour vous et de Sa part un avertisseur explicite. Ne placez pas une autre divinité à côté de Dieu ! Oui, je suis pour vous et de Sa part un avertisseur explicite. [18] » (Cor. Sourate 51, v. 50-51).
Lorsque nous évoquons la retraite de Jîlânî dans sa vie spirituelle, nous devons parler de siyâha plutôt que de khalwa. La siyâha est une forme mobile de khalwa. L’un des rares à en avoir parlé d’une manière détaillée est le grand soufi égyptien Abû l-Hasan al-Shatanûfî (8e H). À cet effet, il a cité dans son K. Bahjat al-asrâr (La joie des mystères) le déroulement de la siyâha de Jîlânî qui constitue, à nos yeux, un exemple par excellence de la khalwa. Il voulait construire une image typique de ce qu’affrontent les soufis dans leur retraite. Jîlânî disait que lorsqu’il commença son errance, il fut exposé à de multiples états (ahwâl). Au départ, il a essayé de lutter, pensant pouvoir les maîtriser (malakahâ), mais au final, il perdait conscience et ne ressentait plus son existence, au point qu’il devint complètement désorienté et marcha dans le désert sans savoir où il allait. Jîlânî affirme être resté 25 années dans le désert d’Iraq, dans l’errance, sans que personne n’ait pu le voir. Seul al-Khidr [19] est venu le rencontrer. Selon le commentaire traditionnel du Coran (sourate 18 « al-Kahf »), c’est un compagnon du Prophète biblique Moïse. Il lui a immédiatement imposé la condition de ne plus désobéir, raconte Shatanûfî, ensuite, il lui a demandé de rester dans un lieu fixe et Jîlânî ne put que se plier à sa demande en passant trois années au même endroit. Une fois par an, al-Khidr venait le voir pour savoir dans quel état il se trouvait [20]. Durant cette période difficile, tous les plaisirs et les séductions se manifestèrent devant Jîlânî, sous de multiples et étranges facettes. Mais la grâce de Dieu venait le protéger contre toutes ces tentations. Il voyait les démons (shayâtîn) qui venaient pour le combattre, mais il finissait toujours par reprendre ses forces et les repousser [21].
Jîlânî vécut de longues années dans la mujâhada [22] (combat Spirituel), au milieu des ruines (kharâb) comme celles de Kharg [23]. Chaque année, il recevait une robe en laine (jubbat sûf) de la part d’un certain homme. À cette époque, il était connu pour son mutisme (takhkharus), sa stupidité (balah) et sa folie (junûn) et il marchait pieds nus. Il disait aussi que, pendant sa mujâhada, il entendait une voix qui disait : « Ô ‘Abd al-Qâdir ! On ne t’a pas donné la vie pour dormir. On t’a adoré alors que tu n’étais rien, et maintenant que tu es quelqu’un, ne sois pas inattentif ». Le but de l’ensemble des soufis initiés dans la voie est d’espérer atteindre, grâce à la khalwa, ce que Jîlânî appelait : « wujûd thânî » (litt. deuxième existence) [24]. Cette appellation signifie dans le vocabulaire soufi, l’état de baqâ [25] avec Dieu (bi-Llâhi) après l’anéantissement en Lui (fîhi). Pour atteindre son objectif, Jîlânî a été attiré vers plusieurs portes, comme disait Shatanûfî, dont voici la liste : « tawakkul (abandon confiant en Dieu), shukr (remerciement), taslîm (agrément), qurb (proximité), mushâhada (contemplation) ». Il trouva une grande foule devant toutes ces portes, sauf une seule, bâb al-faqr (porte de la Pauvreté). Il entra par cette porte et vit soudainement tout ce qu’il avait laissé derrière lui et obtint le fath (ouverture spirituelle) d’un grand trésor (kanz akbar) [26].
Notes
[1] Il a été noté qu’« un pays comme le Brésil par exemple compte 103 archives ouvertes […]. Par ailleurs le nombre des AO de ce pays est de 5 à 8 fois supérieur au nombre total des AO des 22 pays arabes ». Mohamed Ben Romdhane et Tarek Ouerfelli, « L’offre des archives ouvertes dans le monde arabe : recensement et évaluation », Conférence donnée à l’Université de la Manouba, Colloque « Métiers de l’information : des bibliothèques et des archives à l’ère de la différenciation numérique », Décembre 2012.
[2] La situation change complètement pour les revues en libre accès, puisque l’Algérie est la plus active dans le monde arabe avec 30 revues devançant ainsi l’Arabie Saoudite, avec seulement 17 revues. Idem.
[3] Toutes les autres archives appartiennent à des institutions universitaires.
[4] Litt. manuscrit.
[5] Mohamed Ben Romdhane et Tarek Ouerfelli, Décembre 2012.
[6] الخلوة و العزلة و الكشف أقسام بيان في الجلوة
[7] Dans cet article, nous avons transcrit les consonnes arabes de la manière suivante : (le ح par h), (le ص par s), (le ض par d), (le ط par t), (le ظ par z) et (le ع par ‘). Les voyelles : (le ا par â), (le و par û), et (le ي par î).
[8] السماع أحكام في رسالة
[9] المبهتة السماع مسائل عن المسكتة الأجوبة
[10] الشاذلية الطريقة على التصوف في كتاب
[11] Nous précisons que ce manuscrit ne traite pas le sujet de la khalwa dans son texte, c’est la raison pour laquelle nous tenons à le présenter d’une manière rapide. Il nous a servi, uniquement, pour traiter le sujet du « Nom suprême » employé dans les prières des adeptes de la khalwa.
[12] رسالة في الخلوة
[13] Le cahier, selon la définition traditionnelle, est un ensemble de bi-feuillets emboîtés les uns dans les autres et unis par un même passage du fil de reliure. Le cahier peut éventuellement se composer d’un seul bi-feuillet, ou même d’un feuillet dépareillé, cousu indépendamment. Maria Luisa Russo, « Connaître et conserver le manuscrit islamique », dans Alessandro Giacomello et Alessandro Pesaro, dir., Sauvegarde des bibliothèques du désert, Udine, Litho Stampa, 2009,p. 122.
[14] Le naskhî est une écriture cursive, il est natif du 12e siècle où déjà, la civilisation arabe a conquis l’essentiel de ses outils intellectuels et esthétiques. Ce style calligraphique s’imposa aux lettrés musulmans comme l’une des écritures les plus raffinées. Il est de Mossoul, une ville d’Iraq. Malek Chebel, L’imaginaire arabo-musulman, Paris, Presses Universitaires de France, 2015, p. 53.
[15] En arabe : Jâmi’at al-malik Sa’ûd ; en anglais : King Saud University ou KSU. Construite en 1957 à Riyad, elle devient la première université en Arabie saoudite, et porte le nom de son fondateur Sa’ûd Ibn ‘Abd al-‘Azîz Âl Sa’ûd. Elle a eu pour nom Université de Riyad jusqu’en 1982. La bibliothèque de la Fondation offre à ses lecteurs plus de 610 000 volumes de documents.
[16] La tarîqa l-Qâdiriyya compte parmi les plus anciennes et les plus importantes confréries de l’Islam, tirant son nom du « sultan des saints » (sultân al-awliyâ) comme on l’appelle souvent, ‘Abd al-Qâdir al-Jîlânî (6e H), le grand Patron de Bagdad, celui que l’on entend qualifier aussi de pôle mystique de l’Orient.
[17] ‘Abd al-Qâdir AL-JÎLÂNÎ, al-Tarîq ilâ Llâh, kitâb ‘an al-khalwa wa l-bay’a wa l-asmâ al-sab’a, présenté par Muhammad Ghasân Nasûh ‘Azqûl, 2e éd. Damas, Dâr al-Sanâbil, 1994.
[18] فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (51)
[19] al-Khidr : (turc. Hizir), symbolise dans la tradition turque la végétation renaissante du printemps. On croit que lorsque ce personnage se manifeste sur la terre, l’herbe sèche reverdit sur son passage. Un autre trait de sa personnalité légendaire est qu’il vient au secours des êtres en détresse, plus particulièrement de ceux qui sont en danger de naufrage, en mer, ou égarés dans le désert. Boratav,p. N. « Khidr-Ilyâs ». Encyclopédie de l’Islam. Brill Online, 2013.
[20] al-Khidr a connu les saints dès le commencement, selon les décrets divins (maqâdîr). À ce propos, G. Gobillot disait : « Il [al-Khidr] a désiré se joindre à eux et c’est ainsi que l’immortalité lui a été accordée. Il est parmi eux au long des siècles. Il ressuscitera avec eux à la fin des temps, avec la communauté de Muhammad. Geneviève Gobillot, « Le Mahdî, le khatm al-awliyâ et le qutb. Évolution des notions entre sunnisme et chiisme », Mélanges de Sciences Religieuses, 2002, vol. 59,p. 10.
[21] Abî l-Hasan Al-Shatanûfî, Bahjat al-asrâr wa ma’dan al-anwâr, Le Caire, Al-Maktaba al-Azhariyya li-l-turâth, 2001,p. 44.
[22] al-Mujâhada (combat Spirituel) : cela consiste à mener l’âme à ses limites corporelles et ainsi, de contrecarrer les passions (charnelles) en tout état. Muhyi l-Dîn Ibn ‘Arabî, Kitâb istilâh al-sûfiyya [Le livre des termes techniques du soufisme], introduit et traduit de l’arabe par Slimane Rezki, Paris, Tabernacle des Lumières, 2010,p. 12.
[23] Jîlânî (6e H) a construit un ribât (refuge) soufi à côté de son école où on enseignait les sciences du shar’ (Loi islamique) à Bagdad. Cet attachement était une première au tour de la relation entre le tasawwuf et le fiqh à cette époque.
[24] Al-Shatanûfi, op. cit., p. 45.
[25] Selon Ibn ‘Arabî (7e H), le Baqâ (Permanence) est la vision de l’homme qui voit réellement l’autorité d’Allâh sur toute chose. Alors que pour Qushayrî (5e H), ce terme signifie la stabilité, l’immobilité, en fait la réalisation la plus centrale. L’état de « Permanence » est celui de l’état de conscience rattaché à notre condition la plus stable, c’est-à-dire, celle que nous vivons quotidiennement sans effort de concentration particulier. Cependant, il ne correspond pas à l’état du profane mais à celui du connaissant qui a traversé les neuf sphères et s’est stabilisé dans l’état central. Ibn ‘Arabî, Kitâb istilâh al-sûfiyya, op. cit., p. 9.
[26] Al-Shatanûfî, op. cit., pp. 46- 47.