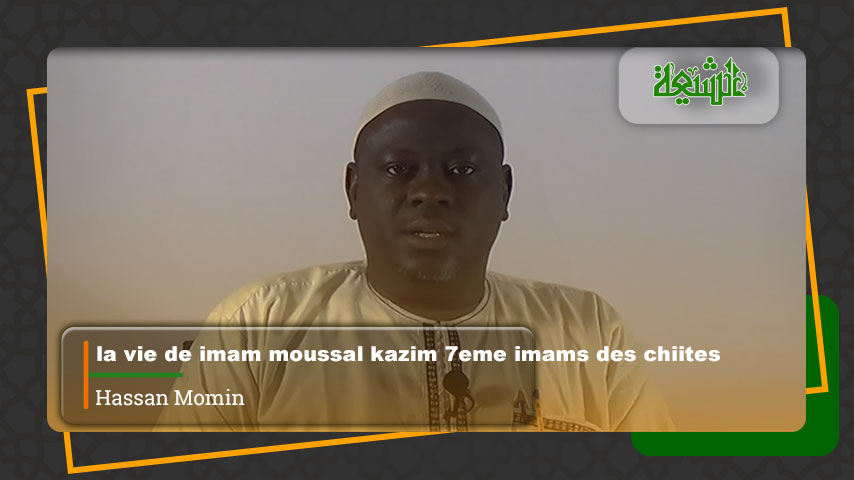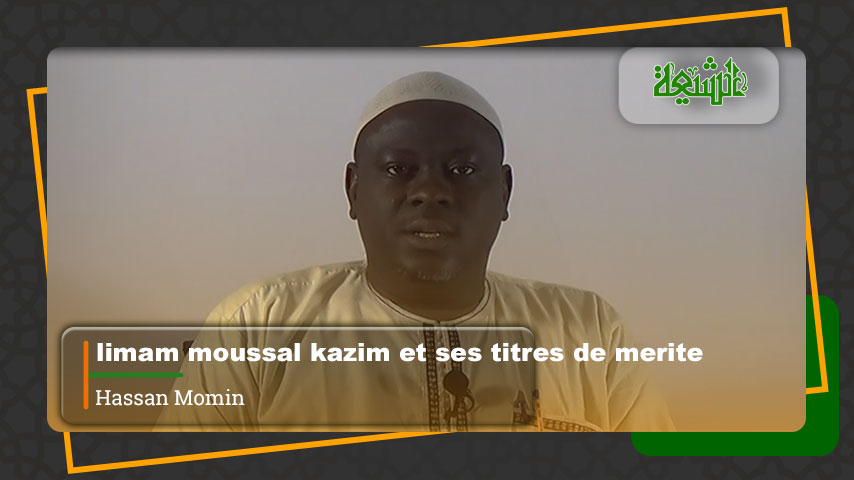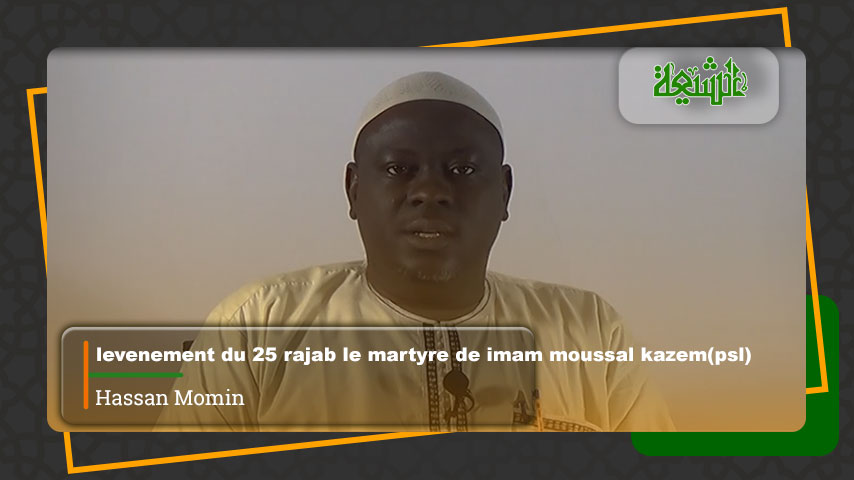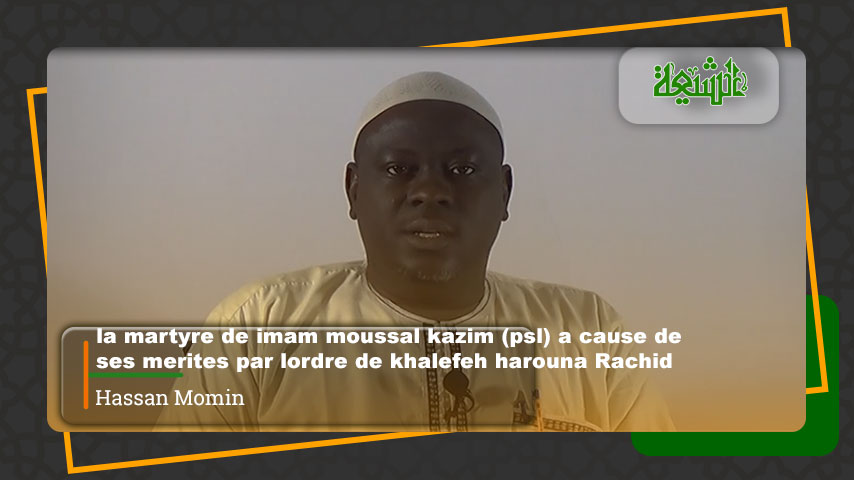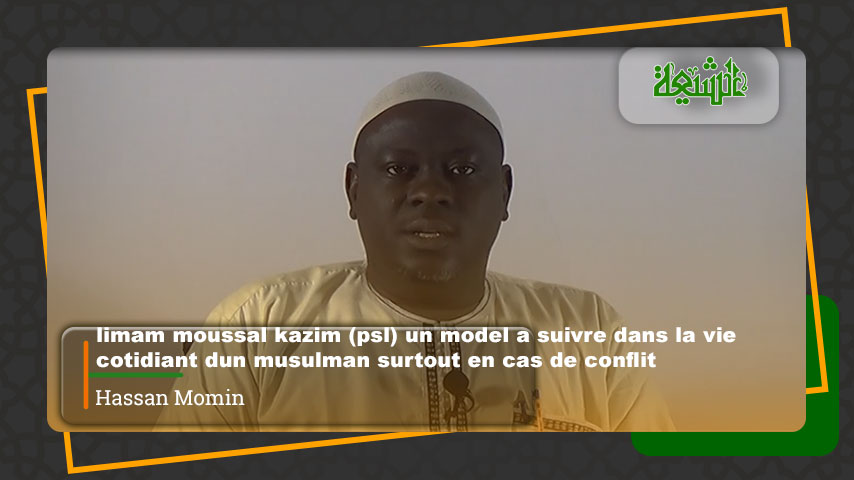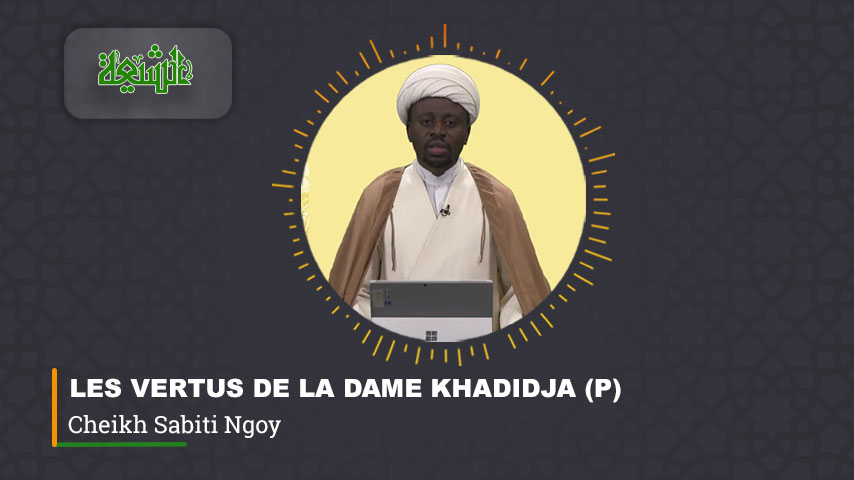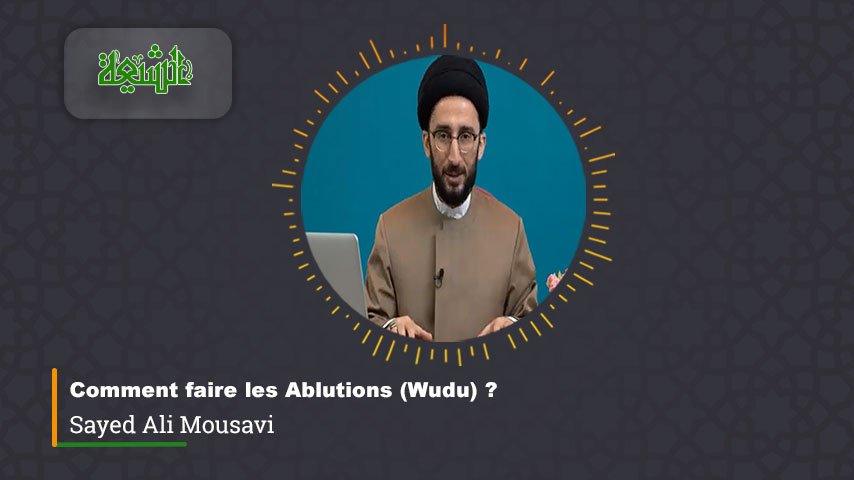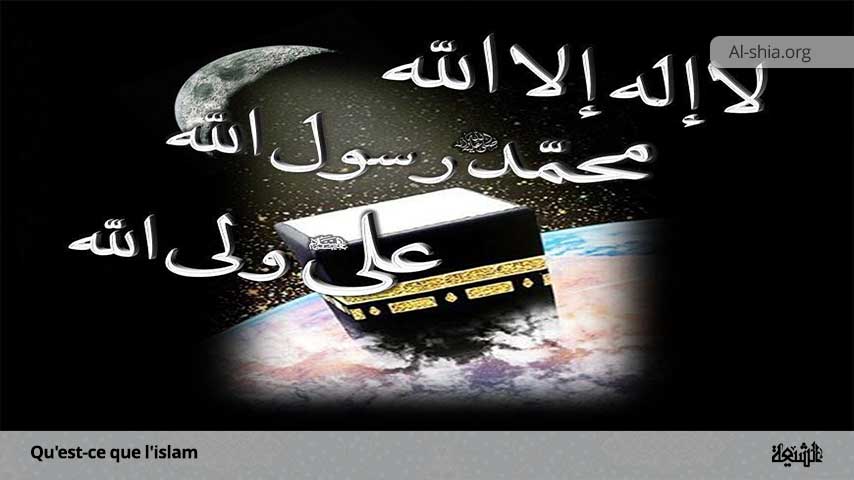Le hijab (voile) du point de vue du judaïsme et Islam
Introduction
La culture du hijab est depuis longtemps l’un des symboles religieux importants visant, selon les diverses religions et elle est un principe qui tire ses origines dans les textes religieux, à préserver la dignité et la personnalité des femmes et l’intimité familiale. L’importance de la question du hijab est telle qu’en plus d’élever le statut de la femme dans les affaires personnelles et sociales, elle joue un rôle important dans le contrôle des instincts sexuels et dans la prévention de l’affaiblissement de l’institution familiale et de la progression de la corruption sociale. C’est pourquoi, en raison du rôle précieux du hijab et de la chasteté, l’arrogance du monde et l’occident en général, cherchent à remplacer et à promouvoir la culture de la nudité et de l’anti-hijab sous prétexte de liberté et de droits de la femme. Le présent article met en évidence le hijab (voile) du point de vue du judaïsme et Islam.
Signification lexicale et expressive
Le « hijab » veut dire un voile ou un rideau qui se place entre deux choses.[1] Mais comme l’affirment les exégètes et les chercheurs, le mot hijab (voile) en tant que vêtement et couverture pour les femmes, est une nouvelle expression devenue courante à notre époque. Dans le passé, cette expression était plus particulièrement utilisée par les dignitaires religieux avec le mot « Sitr » qui veut dire, voile, ou rideau en arabe.[2] Donc le terme hijab signifie obstacle, une chose qui sépare deux choses ; il signifie aussi couvrir. Mais de nos jours, les gens ordinaires et les textes religieux utilisent le terme hijab pour désigner la couverture religieuse exigée pour les femmes.
Historique Du « Hijab »
Je n’ai de l’aspect historique de la question qu’une information incomplète: notre connaissance historique ne serait complète que dans la mesure où nous pourrions émettre une opinion relative à tous les peuples antécédents à l’Islam. Une chose est pourtant certaine, c’est que le « hijab » a existé au sein de certains peuples antérieurement à l’Islam.
Selon ce que j’ai pu lire dans les ouvrages s’y rapportant, le « hijab » a existé dans la Perse antique, chez le peuple juif et probablement en Inde, et y était plus strict que ce qu’en a énoncé la Loi islamique. Mais il n’existait pas dans l’Arabie païenne et apparut chez les arabes par l’intermédiaire de l’Islam.
Dans son Histoire de la Civilisation[3], Will Durrant écrit au sujet du peuple juif et de la Loi du Talmud:
« Si une femme transgressait la Loi juive – sortant par exemple tête nue en public, filant sur la voie publique, se confiant à n’importe quel genre d’homme ou élevant tant la voix en parlant chez elle que les voisins pouvaient entendre ses propos-, l’homme avait alors le droit de divorcer sans devoir restituer la dot. »
Ainsi, le « hijab » qui avait cours chez le peuple juif était beaucoup plus strict et plus sévère que le « hijab » islamique, comme nous l’expliquerons par la suite. Will Durrant écrit au sujet des anciens persans: « Au temps de Zoroastre, les femmes jouissaient d’un rang élevé et circulaient en public en toute liberté et de façon ouverte… » [4]
« Après Darius, écrit-il ensuite, la condition des femmes connut un déclin, en particulier au sein de la couche riche. Les femmes pauvres, nécessairement amenées à circuler parmi les gens pour travailler, préservèrent leur liberté. Mais en ce qui concerne les autres femmes, la réclusion qui leur était imposée en période menstruelle fut graduellement prolongée jusqu’à embrasser la totalité de leur vie sociale, et ceci est tenu pour la base même de la réclusion chez les musulmans.
Les femmes appartenant aux couches élevées de la société n’osaient plus sortir de chez elles que dans des palanquins couverts, et jamais il ne leur était permis d’être publiquement en relation avec des hommes; les femmes mariées n’avaient le droit de voir aucun homme, pas même leur père ni leur frère. Dans les fresques qui subsistent de la Perse antique, n’apparaît aucun visage de femme, et aucune allusion ne semble y être faite… »
Comme vous le voyez, un « hijab » strict et sévère dans la Perse antique, à tel point que même le père et le frère devenaient étrangers à la femme mariée.
Selon Will Durrant, les sévères prescriptions appliquées conformément aux anciens usages et rites issus du Mazdéisme au sujet de la femme menstruée qui était prisonnière dans une pièce, tous s’en éloignant durant la période de ses menstrues et s’abstenant de toute relation avec elle, ont été la cause majeure de l’apparition du « hijab » dans la Perse antique. De telles prescriptions relatives à la femme menstruée étaient également appliquées chez les juifs.
Mais où veut-il donc en venir lorsqu’il dit: « Ceci est tenu pour la base même de la réclusion musulmans »?
Veut-il dire que la pratique du « hijab » chez les musulmans a elle aussi pour cause les âpres prescriptions appliquées au sujet de la femme menstruée?! Or nous savons tous qu’en Islam, de telles prescriptions n’existent pas et n’ont jamais existés. La femme menstruée y est seulement exemptée de certaines pratiques religieuses obligatoires comme la prière et le jeûne, et l’accouplement n’est pas permis avec elle durant la période de ses menstrues. Mais aucune sorte d’interdiction dans ses relations avec autrui ne contraint en pratique la femme menstruée à la réclusion.
Et s’il veut dire que le « hijab » d’usage parmi les musulmans est une pratique transmise aux autres musulmans par les iraniens après leur conversion à l’Islam, c’est là encore un propos erroné. Car les versets coraniques concernant le « hijab » furent révélés antérieurement à la conversion à l’islam des iraniens.
Ces deux questions sont rendues intelligibles par les autres propos de Will Durrant, à savoir qu’il prétend à la fois que le « hijab » prit cours au sein des musulmans par l’intermédiaire des iraniens après leur conversion à l’Islam, et que le fait de s’abstenir de relations sexuelles avec la femme menstruée a influé sur le « hijab » des femmes musulmans ou, du moins, sur leur retraite:
« La relation des arabes avec l’Iran, écrit-il, compta parmi les causes de l’instauration du « hijab » et de la pédérastie dans le monde de l’Islam. Les arabes s’effrayaient de la séduction de la femme, dont ils étaient éternellement épris, et compensaient son impact naturel par le soupçon commun des hommes quant à la chasteté et à la vertu féminines. Omar* disait à son peuple de délibérer avec les femmes et d’agir à l’encontre de leur avis. Mais au premier siècle de l’Islam, les musulmans n’avaient pas encore inséré la femme dans le « hijab ». Hommes et femmes se fréquentaient mutuellement, marchaient dans les rues côte à côte et faisaient la prière, ensembles dans la mosquée.
« Le « hijab » et la possession d’eunuques devinrent courants à l’époque de Walid II (126-127 de l’Hégire). La réclusion des femmes apparut du fait qu’elles étaient interdites aux hommes durant la période des menstrues, et des suites de couches. » [5]
Il dit ailleurs:
« Le Prophète avait recommandé le port de vêtements amples, mais certains arabes négligèrent cette injonction. Dans toutes les couches sociales on portait des parures. Les femmes paraient leur corps de boléros, de ceintures brillantes, de vêtements amples et bigarrés; elles attachaient joliment leurs cheveux, les laissaient pendre de chaque côté de leur visage ou les faisaient tomber en nattes derrière leur tête; elles les enjolivaient parfois avec des fils de soie noire; elles se paraient souvent de pierres précieuses et de fleurs. Après l’an 97 de l’Hégire, elles se mirent à se couvrir le visage d’un voile partant de sous les yeux, et dès lors cette habitude prévalut ainsi. » [6]
Will Durrant écrit au sujet des anciens perses:
« Rien ne s’opposait à la possession de concubines. Celles-ci, comme les amantes grecques, étaient libres de paraître en public et d’assister aux festins des hommes, tandis que les épouses légitimes étaient ordinairement maintenues à l’intérieur des maisons. Cet ancien usage perse fut transmis à l’Islam. » [7]
Will Durrant s’exprime comme s’il n’avait pas existé, au temps du Prophète, le moindre commandement relatif au « couvrement » de la femme, et que le Prophète n’avait recommandé que le port de vêtements amples! Et que les femmes musulmanes, jusqu’à la fin du premier siècle et au début du deuxième siècle de l’Hégire, circulaient absolument sans « hijab ». Or il n’en fut assurément pas ainsi. L’histoire témoigne formellement du contraire.
Si la femme de l’Arabie païenne fut sans aucun doute telle que la décrit Will Durrant, l’Islam engendra une transformation en ce domaine. Aïcha* louait toujours les femmes « Ansar »* de la façon suivante: « Bravo aux femmes « Ansar »! Dès la révélation des versets de la sourate « La Lumière », on n’en vit plus une se rendre au-dehors comme auparavant. Elles couvraient leur tête de foulards noirs, et il semblait que s’y étaient posés des corbeaux. » [8] Dans les Traditions d’Abou Dawoud[9], sont rapportés d’Oum Salama* des propos identiques, avec cette différence qu’elle dit: « Après la révélation du verset de la sourate « Les coalisés » (« Ho, le Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leurs voiles; C’est pour elles le meilleur moyen de ne pas se faire connaître et de ne pas être offensées »), les femmes « ansar »* agirent de la sorte. »
Dans son ouvrage intitulé « Trois années en Iran », le Comte Gobineau se montre convaincu lui aussi que le sévère « hijab » de l’époque de Sassanides* subsista chez les iraniens à l’ère de l’Islam. Il considère que la Perse Sassanide ne connut pas seulement le « couvrement » de la femme, mais également le fait de garder la femme cachée.
Il prétend que les caprices des prêtres zoroastriens et des princes de cette époque étaient tels que quiconque avait une belle épouse ne laissait personne prendre conscience de son existence, la cachant dans la mesure du possible, car s’il apparaissait qu’une telle femme vivait chez lui, il n’en serait plus le possesseur, ni à l’occasion celui de sa propre vie.
Jawãharlãl Nehru, ancien premier ministre de l’Inde, considère lui aussi que le « hijab » fut introduit dans le monde de l’Islam par les peuples non-musulmans- Rome et l’Iran. Dans son ouvrage « Regard sur l’histoire du monde », au cours d’une apologie de la civilisation islamique, il fait allusion aux transformations qui apparurent par la suite, écrivant notamment:
« Un changement important et regrettable se produisit également au fur et à mesure, et ceci concernant la condition des femmes. L’usage du « hijab » et du voile n’existait pas chez les femmes arabes. Celles-ci ne vivaient ni séparées des hommes ni cachées d’eux, paraissant au contraire dans les endroits publics, se rendant à la mosquée et aux assemblées de prédication, à quoi elles procédaient même elles-mêmes.
Mais sous l’effet de leurs victoires, les arabes empruntèrent graduellement de plus en plus une tradition qui existait dans deux empires voisins, l’Empire Romain Oriental et l’Empire Perse. S’ils écrasèrent l’Empire Romain et traitèrent avec l’Empire Perse, ils se soumirent néanmoins aux habitudes et aux mœurs déplaisantes de ces deux empires. Selon ce que l’on a raconté, ce fut en particulier sous l’effet de l’infiltration des empires byzantin et perse que s’instaura chez les arabes l’habitude de la réclusion des femmes et de leur séparation des hommes. Le système du « harem » s’instaura au fur et à mesure, et hommes et femmes se trouvèrent séparés les uns des autres. »
De tels propos sont erronés. Simplement, par la suite, sous l’effet des relations des arabes musulmans avec les récents convertis non arabes, le « hijab » devint plus sévère qu’il ne l’était au temps du Noble Prophète, mais il serait inexact de dire que l’Islam n’a prêté à l’origine aucune attention au « couvrement » de la femme.
Il ressort des propos de Nehru que les romains -peut-être sous l’influence du peuple juif- connaissaient également le ‘ »hijab », et que la tradition du « harem » s’introduisit elle aussi à la cour des califes musulmans par Rome et par l’Iran. D’autres ont également confirmé ce point.
Un « hijab » strict et sévère régna également en Inde, mais y existait-il avant la pénétration de l’Islam en Inde, ou s’y instaura-t-il postérieurement, les hindous musulmans adoptant le « hijab » féminin sous l’influence des musulmans et en particulier des iraniens? Cela n’est pas tout à fait clair. Une chose est certaine, c’est que le « hijab » hindou a été strict et sévère comme dans la Perse antique. Il ressort des propos de Will Durrant, dans le second volume de son Histoire de la Civilisation, que le « hijab » s’instaura en Inde par l’intermédiaire des iraniens.
Nehru poursuit ainsi les propos rapportés plus haut: « Ce déplaisant usage devint hélas peu à peu une des caractéristiques de la société islamique, et l’Inde l’adopta elle aussi lorsque les musulmans y pénétrèrent. »
D’après Nehru, le « hijab » s’est donc introduit en Inde par l’intermédiaire des musulmans.
Mais si nous considérons la tendance pour l’ascétisme et le renoncement au plaisir comme une des causes de l’apparition du « hijab », il nous faut admettre que l’Inde a adopté le « hijab » depuis les temps les plus reculés, car elle a été un des centres séculaires de l’ascétisme et de la conception du caractère impur des plaisirs matériels.
« L’éthique sexuelle, dit Russell dans « Le mariage et la morale »[10], comme on le voit dans les sociétés civilisées, prend source à deux origines: la tendance patriarcale et la conviction ascétique du caractère vil de l’amour. Aux époques antérieures au Christianisme et dans les pays d’Extrême-Orient jusqu’à l’heure actuelle, l’éthique sexuelle découle uniquement de la première source. Y font exception l’Inde et l’Iran, où apparut manifestement la quête de mortification qui se dissémina à travers le monde entier. »
Quoi qu’il en soit, une chose certaine est que le « hijab » existait dans le monde antérieurement à l’Islam, qui n’en fut pas le promoteur. Quant à savoir si la limite du « hijab » islamique et du « hijab » existant chez les anciens peuples était ou non la même, et si la raison et la philosophie qui rendent le « hijab » nécessaire selon l’Islam sont ou non celles qui devinrent en d’autres endroits du monde l’origine de son apparition, ce sont là des questions dont nous allons parler en détail dans les chapitres suivants.
Hijab du point de vue du Islam
Hijab dans le Coran
Le mot hijab a été mentionné sept fois dans le Coran (signifiant le plus souvent obstacle) : Coran 7:46, Coran 17:45, Coran 19:17, Coran 33:53, Coran 38:32, Coran 41:5, Coran 42:51.
Le terme hijab, utilisé dans tous ces versets concerne le rapport entre l’Homme et Dieu, le Hijab y étant un obstacle. Seul le verset 53 de la sourate al-Ahzâb, parle de hijab au sujet de femmes. Le voici :
« Ô vous qui croyez !, n’entrez dans les appartements du Prophète que [quand] il vous est donné permission pour un repas ! [N’entrez point alors] sans attendre le moment de [ce repas] ! Quand toutefois vous êtes invités, entrez ! Dès que vous avez pris le repas, retirez-vous sans vous abandonner, familiers, à un discours. Cela offense le Prophète et il a honte de vous. Mais Allah n’a pas honte de la vérité. Quand vous demandez un objet aux [épouses du Prophète], demandez-le de derrière un voile ! Cela est plus décent pour vos cœurs et leurs cœurs. Il n’est pas [licite] à vous d’offenser l’Apôtre d’Allah, ni d’épouser jamais ses épouses, après lui. C’est, au regard d’Allah, [péché] immense «
Coran, s 33, v 53, Traduction Régis Blachère
Ce verset dit aux hommes de parler aux femmes du Prophète derrière un rideau et que les femmes du Prophète ne doivent pas être vues par les hommes étrangers à sa maison, car c’est mieux pour la pureté de leurs cœurs. L’utilisation du mot « Hijab » fait que ce verset est populairement reconnu comme le Verset du Hijab, mais il ne s’adressait qu’aux épouses du Prophète à l’époque, sans obliger les autres femmes.
L’engagement des épouses du Prophète à obéir à cette règle, et la compréhension générale des premiers musulmans, montrent que la raison initiale du hijab était de respecter la dignité et la position du Prophète (s), car il était considéré comme un respect spécial pour ses épouses.
Dans le verset 59 de la sourate al-Ahzab, le terme jilbâb est utilisé, signifiant grand-voile :
« Ô Prophète !, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des Croyants de serrer sur elles leurs voiles ! Cela sera le plus simple moyen qu’elles soient reconnues et qu’elles ne soient point offensées. Allah est absoluteur et miséricordieux »
Coran, s 33, v 59, Traduction Régis Blachère
Dans ce verset, on voit l’obligation pour les épouses et les filles du Prophète (s), ainsi que pour les femmes pieuses, de se couvrir d’une robe (Jilbab), afin de se protéger contre les humiliations.
Il faut dire que le terme jilbab a aussi diverses significations et son sens et usage varient selon société et époque. Mais il est traduit communément comme une grande robe couvrant tout le corps.
Mais il y a aussi plusieurs interprétations sur ce que signifie « Ce qui les rend susceptibles d’être reconnus » et de qui ce verset les sépare.
En se référant à l’occasion de la révélation, certains pensent que le Jilbab a été émis pour distinguer les femmes libres des esclaves et les mettre à l’abri des regards mal veillant.
Néanmoins, certains interprètes pensent que le port du Jilbab était destiné à distinguer les femmes vertueuses et modestes des autres. Bien que la plupart des interprètes, des savants sunnites et certains savants chiites citent ce verset pour expliquer l’obligation du hijab, certains pensent néanmoins que le commandement de ce verset n’est ni obligatoire, ni destiné au grand public. Ils pensent que le Jilbab représente simplement la vertu d’une femme, montre qu’elle est libre, et que ce vêtement est un moyen pour garantir le respect de la femme qui le porte.
« Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines ; et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu’elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. »
Coran, sourate an-Nûr, verset 31
Dans le verset 31 de la sourate al-Nûr, le terme hijâb ou jilbâb ne sont pas utilisés, pourtant ce verset est connu comme le verset du hijab. Car c’est seulement ici qu’il est ordonné aux femmes croyantes de baisser leur regard, de couvrir leurs parties intimes, de cacher leurs ornements, de couvrir leur poitrine, de ne montrer leurs ornements et parures qu’à des personnes spécifiques (avec qui le mariage est interdits ; ils sont mentionnées dans le verset).
Ce verset est le document le plus important que les savants utilisent pour argumenter l’obligation de se couvrir et ses limites. Les hadiths sur le hijab ont surtout contribué à l’interprétation et à l’explication de ce verset, en particulier la partie sur اِلّا ما ظَهَرَ (au-delà de ce qui est [acceptablement] visible) et la règle sur le fait de les regarder. Bien sûr, d’autres versets ont parfois été mentionnés, comme le verset 33:33 du Coran :
« Demeurez dans vos demeures ! Ne vous produisez point en vos atours, à la manière de l’ancienne Gentillité (jâhiliyya) ! Accomplissez la Prière ! Donnez l’Aumône (zakât). Obéissez à Allah et à Son Apôtre ! Allah veut seulement écarter de vous la souillure !, ô membres de la Maison [du Prophète] !, et [Il veut] vous purifier totalement »
Coran, s 33, v 33, Traduction Régis Blachère
Mais aussi le verset 30 de la sourate al-Nur adressé aux hommes :
« Dis aux Croyants qu’ils baissent leurs regards et soient chastes. Ce sera plus décent pour eux. Allah est bien informé de ce qu’ils font. »
Coran, sourate an-Nûr, verset 30 ; Traduction de Régis Blachère
Certaines traditions (hadiths) expliquent également d’autres approches du hijab, comme le cas des personnes âgées (celles qui n’ont plus la chance de tomber enceinte) pour qui le problème du hijab ne pose pas de questions importantes (sourate 24, verset 60), ou la question de comment se couvrir devant certains hommes ou les enfants qui n’ont pas atteint la puberté.
Dans le hadith
Les hadiths soulignant l’obligation pour les femmes de porter le hijab devant les non-Mahrams sont Mutawatir (rapportés par des chaînes de transmission multiples et authentiques).[11] L’Ayatollah Makârim Shîrâzî a classé tous ces hadiths en sept groupes, dont certains sont décrits ci-dessous[12] :
Les hadiths qui expliquent une partie du verset 31 de la sourate an-Nûr : « … de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît … » [13]
Selon ces hadiths, les « atours que ce qui en paraît » dans le verset font allusion au visage et aux mains (des bouts des doigts jusqu’aux poignets) et pour le reste du corps, le respect du hijab est obligatoire.[14]
Les hadiths expliquant le verset 60 de la sourate an-Nûr : « Nul grief aux femmes atteintes par la ménopause et n’espérant plus mariage si elles déposent leurs voiles, [sauf à] se montrer sans atours. S’abstenir est toutefois un bien pour elles. Allah est audient et omniscient. »
Dans ces hadiths, il est permis aux femmes âgées qui n’ont plus d’attrait pour le mariage, d’enlever leur voile.[15] Donc, pour les autres femmes, il est obligatoire de couvrir leur corps et leurs cheveux.[16]
Les hadiths dans lesquels on a posé des questions sur le hijab des servantes, et en réponse, les limites de leur hijab ont été exposées de manière un peu plus relâchée.[17] Dans ces hadiths, on a posé des questions sur les exceptions (le hijab des servantes), ce qui montre que le principe du hijab était considéré comme acquis.[18]
Les hadiths selon lesquels les filles doivent observer le hijab et se couvrir des non-Mahrams à partir de l’âge de la puberté.[19] Dans ces hadiths, on a posé des questions sur le moment où le hijab devient obligatoire pour les femmes et les filles, ce qui montre que le principe du hijab était considéré comme acquis.[20]
Hijab dans la Jurisprudence
Signification dans la jurisprudence
Les sources jurisprudentielles antérieures faisaient référence à la couverture des femmes par le mot « Sitr » et le mot hijab signifiait simplement couvrir. La jurisprudence moderne et les gens ordinaires utilisent toutefois le mot hijab pour désigner le fait de couvrir les femmes. Bien que cette nouvelle signification du hijab soit utilisée dans la jurisprudence et par les gens du commun depuis un siècle au maximum, certaines narrations et certains textes jurisprudentiels ont également utilisé le mot hijab pour désigner le fait de couvrir les femmes.
Abu Hilal al-‘Askary estime que hijab signifie dissimuler et couvrir, afin de se cacher et d’empêcher les autres « d’entrer », et est donc différent de ce que le terme sitr signifie. Par conséquent, certains auteurs ont aujourd’hui envisagé d’utiliser le terme sitr au lieu de hijab. Muhammad Mahdi Shams al-Din pense que l’utilisation de ce mot est une sorte de compromis, car le hijab, en ce qui concerne la façon dont il a été utilisé dans le Coran, est une règle spécifique aux épouses du Prophète (s), et les autres femmes ont seulement été tenues de se couvrir comme indiqué par les règles.
Murtadâ Mutahharî pense que ce déplacement des mots est dû au fait que l’on a confondu la couverture islamique avec la culture compliquée de la couverture des femmes dans d’autres nations, qui exigeait que les femmes restent derrière un rideau et à l’intérieur de la maison. Il est possible que la rigueur des musulmans à l’égard du port du voile par les femmes, influencée par les traditions sociales, soit à l’origine de la délocalisation des mots mentionnés plus haut, sitr ayant perdu sa signification de « rester derrière le rideau ».
Sujets qui abordent le hijab
Dans les traités jurisprudentiels, le hijab n’a pas été mentionné en tant que sujet distinct dans les sources jurisprudentielles, mais il est généralement mentionné sous les sujets autres, à savoir la prière et le mariage ci-dessous :
Prière : ceci traite de l’habillement et de la couverture de la personne qui prie. La différence entre les vêtements de prière (sitr as-Salât) et les vêtements autres que l’on met dans les temps ordinaires, est que les premiers sont obligatoires, indépendamment de la présence d’un étranger, tandis que les seconds font référence à la couverture de la vue des autres. Selon la croyance populaire des chiites, les règles relatives à la couverture pendant la prière ne sont pas liées à la couverture obligatoire en présence d’une personne étrangère.
Mariage : pour discuter de la règle concernant les deux personnes qui se marient et qui voudraient se regarder l’une l’autre lors de la demande en mariage. Les règles relatives à ce cas peuvent être trouvées dans la section générale, ou dans la section sur la couverture. Il convient de noter que le « sitr » et le « regard » sont deux questions différentes, mais qui sont dans certains cas liées entre eux.
Obligation de se couvrir
L’obligation pour les femmes de se couvrir devants les hommes est un accord commun entre les faqîh/juristes de divers confessions islamiques, mais il y a des divergences au sujet de sa définition, ses mesures et ses limites.
Objet de hijab selon le figh
La question de combien faut-il se couvrir, est une question jurisprudentielle dans l’Islam, et cela selon l’interprétation des versets coraniques (qui, eux, parlent uniquement de la couverture du cou et de la poitrine ainsi que de la parure, mais ne parlent pas de cheveux ni des limites du hijab) et des hadiths. Les juristes chiites et sunnites ont divers interprétations à ce sujet, mais dans l’ensemble ils constituent deux catégories principales :
Ceux qui sont d’avis que le corps doit être entièrement couvert à l’exception des mains et du visage
Ceux qui pensent que même les mains et le visage doivent être couvert.
Précisons que ces avis ne concernent pas uniquement les vêtements de la femme mais englobent aussi le regard de l’homme. Autant la femme est censée se couvrir le corps autant l’homme est censé se retenir le regard sur la femme.
Précisons également que selon certains hadiths, l’expression اِلّا ما ظَهَرَ (au-delà de ce qui est [acceptablement] visible) du verset 31 de la sourate 24, signifie le « vêtement ».
Flexibilité au sujet de l’obligation du hijab
Une analyse des divers préceptes jurisprudentiels concernant le hijad et la manière vestimentaire des femmes, montre que ceux-ci ont des degrés et niveaux différents, et ont une certaine flexibilité selon l’environnement dans lequel la femme se trouve.
Philosophie du hijab
Selon la pensée islamique, la question du vêtement et du hijab est une question sociétale et concerne la question de la sécurité morale et la santé étique de la société en appuyant sur la « décence » et la « pudeur ». L’insistance du Coran, dans le rapport homme-femme, et mise sur les vertus de la dignité (‘ifâf) et de la piété (taqwâ), et c’est selon ceci que la pudeur (hayâ) et la décence (‘iffa) sont valorisées.
Les savants ont énuméré plusieurs sagesses expliquant la nécessité de respecter le hijab, dont certaines sont les suivantes :
Tranquillité psychologique : l’absence d’intimité entre hommes et femmes et la liberté de relations sans retenue éveillent et augmentent les tensions et envies sexuelles, transformant le désir sexuel en une soif psychologique et un désir inassouvi. D’autre part, ces désirs illimités et inassouvis sont toujours inatteignables et associés à un sentiment de privation, ce qui mène à des troubles psychologiques et des maladies mentales.[21]
Solidité du lien familial : le respect du hijab pour les femmes renforce le lien familial et favorise l’intimité entre l’époux et l’épouse au sein de la famille. En effet, le voile et le hijab empêchent la satisfaction sexuelle en dehors du mariage, réservant ainsi les plaisirs sexuels au cadre familial, ce qui consolide le lien conjugal.[22]
Stabilité de la société : le non-respect d’une tenue vestimentaire appropriée et la liberté dans les relations hommes-femmes dans la société entraînent une extension des plaisirs sexuels hors du cadre familial, au niveau de la société. Cela affaiblit à son tour la force de travail et l’activité au sein de la société.[23]
Valeur et respect de la femme : selon l’Ayatollah Mutahharî, du point de vue de l’islam, plus une femme est digne et vertueuse, et moins elle s’expose au regard des hommes, plus sa valeur et son respect augmentent.[24] L’Ayatollah Makârim Shîrâzî considère que l’absence de hijab entraîne une dégradation du statut de la femme, affirmant que lorsque la société demande à la femme de se dénuder, il est naturel qu’elle exige d’elle toujours plus d’apparats et d’exhibition. Dans une telle société, la personnalité de la femme est réduite à une marchandise sans valeur, et ses valeurs humaines sont oubliées.[25]
Hijab des hommes
Selon ces principes qui relèvent plutôt des normes socioreligieuses mais aussi morales, ce ne sont pas seulement les femmes qui sont censées se couvrir, mais les hommes sont également obligés de se couvrir et d’obéir aux règles de sitr et ‘ifâf. Toutefois les règles jurisprudentielles concernant les hommes sont bien plus légères.
Hijab du point de vue du judaïsme
En tant qu’une des ordres stricts de la religion juive, le port du voile et la chasteté ont aussi été soigneusement respectés depuis les temps anciens. La prédominance du hijab parmi les Juifs est évidente et confirmée par les historiens de sorte que selon de nombreux historiens et penseurs, le port du voile chez d’autres nations comme les Arabes ou les Iraniens est le fruit de leur relation avec la nation juive. D’ailleurs, l’on n’oublie pas de parler de la rigueur de cette règle chez les femmes juives. « Bien qu’introduit chez les Arabes par l’Islam, le voile était plus répandu chez les nations non arabes. En Iran et parmi les Juifs, ainsi que ceux qui suivaient la pensée juive, l’on constate un hijab beaucoup plus strict que ce qui était requis dans l’Islam ». Précisément mentionné dans la Torah, le port du hijab portait une telle valeur que les les femmes fautives étaient condamnées à enlever temporairement leur hijab.[26]
Or, dans de nombreux autres cas, le port du hijab a été mentionné dans l’ancien testament. En outre, la Torah soulignant l’importance de la différence des vêtements homme et femme, interdit la ressemblance entre les genres : « Une femme ne doit pas porter le costume d’un homme, ni un homme s’habiller d’un vêtement de femme; car l’Éternel, ton Dieu, a en horreur quiconque agit ainsi ». [27] Le judaïsme considère le voile comme un désir naturel. Or, le désir de pureté et d’acquisition des valeurs humaines étant naturel, il n’a pas besoin d’être enseigné. Par conséquent, sur la base de la nature, chaque être humain veut vivre avec dignité. Pour cette raison, même un enfant qui n’a pas encore atteint la maturité déteste l’humiliation. Sans aucun doute, le hijab est l’un des facteurs qui garantissent la personnalité humaine ; enraciné dans le Fitra (nature), le port du voile est de la plus haute importance pour assurer la santé sociale et individuelle. Dans l’histoire d’Adam et Eve, nous lisons dans la Torah : « La femme jugea que l’arbre était bon comme nourriture, qu’il était attrayant à la vue et précieux pour l’intelligence; elle cueillit de son fruit et en mangea; puis en donna à son époux, et il mangea. Leurs yeux à tous deux se dessillèrent, et ils connurent qu’ils étaient nus; ils cousirent ensemble des feuilles de figuier, et s’en firent des pagnes » . Il est en outre déclaré que « L’Éternel-Dieu fit pour l’homme et pour sa femme des tuniques de peau, et les en vêtit ». [28]
La version coranique de cette histoire est la suivante : « Puis, lorsqu’ils [ Adam et Ève ] eurent goûté de l’arbre, leurs nudités leur devinrent visibles. (Al-A’raf, verset 22) . Il est dit dans la Torah qu’après un court séjour au Paradis, équivalent à une demi-journée de l’au-delà, Adam descendit au mont Nudh en Inde, et Ève à Djeddah, en Arabie. Une fois la séparation finie, ils se retrouvèrent alors que tous les deux furent nus. Dieu leur ordonna d’abattre l’une des huit paires de béliers qu’Il leur eut donné du Ciel : Ève en fila la laine. Avec l’aide d’Adam, un long vêtement (jebba) fut tissé pour Adam ainsi qu’une chemise et un foulard à Ève. De cette façon, le corps des premiers humains fut vêtu et ils furent sauvés de la nudité et de la honte.
Racontant la narration mentionnée, certains auteurs affirment : « Avant l’Islam, le hijab et le niqab existait, et l’humanité l’observait au début de la création avant que les lois célestes ne soient révélées ». D’autres trouvent l’ordre du port du voile enraciné dans la structure existentielle de l’être humain, et le considèrent en tant que qualité inhérente à l’homme. Par ailleurs, la tendance naturelle de l’homme pour la bonté exige que la tendance vers le hijab soit naturelle. Ainsi, les femmes ont au fil du temps respecté le hijab. En plus, ce dernier a été apprécié par les Imams Shiites. C’est la raison pour laquelle le port du voile fait définitivement partie de l’histoire de la tradition islamique et a existé depuis l’aube de l’Islam à notre époque. Sur ce, le hijab n’est pas une restriction, mais un fait naturel auquel dépend que l’honneur de la femme : la chasteté est une mesure que la femme doit prendre pour se valoriser contre les hommes et pour maintenir son statut.
Ceux qui cherchent la vérité pensent de façon réaliste en tout temps et en tout lieu : en été, le taux de crimes est plus élevé qu’en hiver. Aux yeux de la plupart des experts, le manque de hijab ou son absence pendant la saison estivale est l’une des causes efficaces de ce problème. D’où la fausseté des affirmations telles que « la pureté d’une femme n’est pas dans ses vêtements, mais dans son cœur», que « le chador est plus excitant », que « l’homme est avide de ce qui est interdit ».
Dans une lettre adressée à sa fille, Géraldine, Charlie Chaplin parle de la nudité en tant que maladie de l’époque ; pour ce comédien et acteur non-musulman le respect du hijab est l’un des facteurs efficaces pour prévenir la corruption. « Ton travail, écrit-il, est très difficile. Je le sais. Ton corps n’est recouvert que par un morceau de soie car l’art peut et apparaîtra nu sur scène, mais c’est pour en revenir habillé et plus propre. Ma fille, il n’y a personne ni rien dans ce monde qui vaille la peine qu’une fille montre ses ongles. […] La nudité, ajoute-t-il, est la maladie de notre époque. Je pense que ton corps devrait appartenir à quelqu’un qui a dévoilé son âme pour toi ».
Notes:
- Ibn Manzour: Lessan al-arabe, l’article sur le hijab
- L’interprétation modèle; vol. 17; p.402; Morteza Motahari, la question du Hijab, p.78
- 12, p. 30 de la traduction persane. Faute d’avoir pu accéder aux textes originaux, nous avons dû traduire les citations d’auteurs non persans à partir du persan (N.d.t.).
- Histoire de la Civilisation, vol. 1, p. 552.
- Ibid, Vol. 11 p. 112.
- Ibid, p. 111.
- Ibid, Vol. 10, p. 233.
- Al-Kach Châf, en commentaire du verset 31 de la sourate La Lumiére (24).
- 2, p. 382
- 135 (traduction persane).
- Makârim Shîrâzî, Kitâb an-Nikâh, vol 1, p 53
- Makârim Shîrâzî, Kitâb an-Nikâh, vol 1, p 53
- Cheikh al-Hurr al-‘Âmilî, Wasâ’il ash-Shî‘a, vol 20, p 201 – 202
- Makârim Shîrâzî, Kitâb an-Nikâh, vol 1, p 55
- Cheikh al-Hurr al-‘Âmilî, Wasâ’il ash-Shî‘a, vol 20, p 202 – 204 ; Subhânî, Nizâm an-Nikâh fî ash-Sharî‘at al-Islâmîyya al-Gharrâ’, vol 1, p 67 – 68
- Makârim Shîrâzî, Kitâb an-Nikâh, vol 1, p 55
- Cheikh al-Hurr al-‘Âmilî, Wasâ’il ash-Shî‘a, vol 20, p 207
- Makârim Shîrâzî, Kitâb an-Nikâh, vol 1, p 55
- Cheikh al-Hurr al-‘Âmilî, Wasâ’il ash-Shî‘a, vol 20, p 228 – 229
- Makârim Shîrâzî, Kitâb an-Nikâh, vol 1, p 56
- ‘Allâma Mutahharî, Ma’aliyi Hijâb, p 77 – 80 ; Makârim Shîrâzî, Tafsîr Nimûni, vol 14, p 443
- ‘Allâma Mutahharî, Ma’aliyi Hijâb, p 81
- ‘Allâma Mutahharî, Ma’aliyi Hijâb, p 84
- ‘Allâma Mutahharî, Ma’aliyi Hijâb, p 86
- Makârim Shîrâzî, Tafsîr Nimûni, vol 14, p 445 – 446
- Torah, Livre des nombres, chapitre 5, paragraphe 18
- , Livre du Deutéronome, chapitre 22, verset 5
- Torah, Genèse, chapitre 3, versets 6, 7, 21